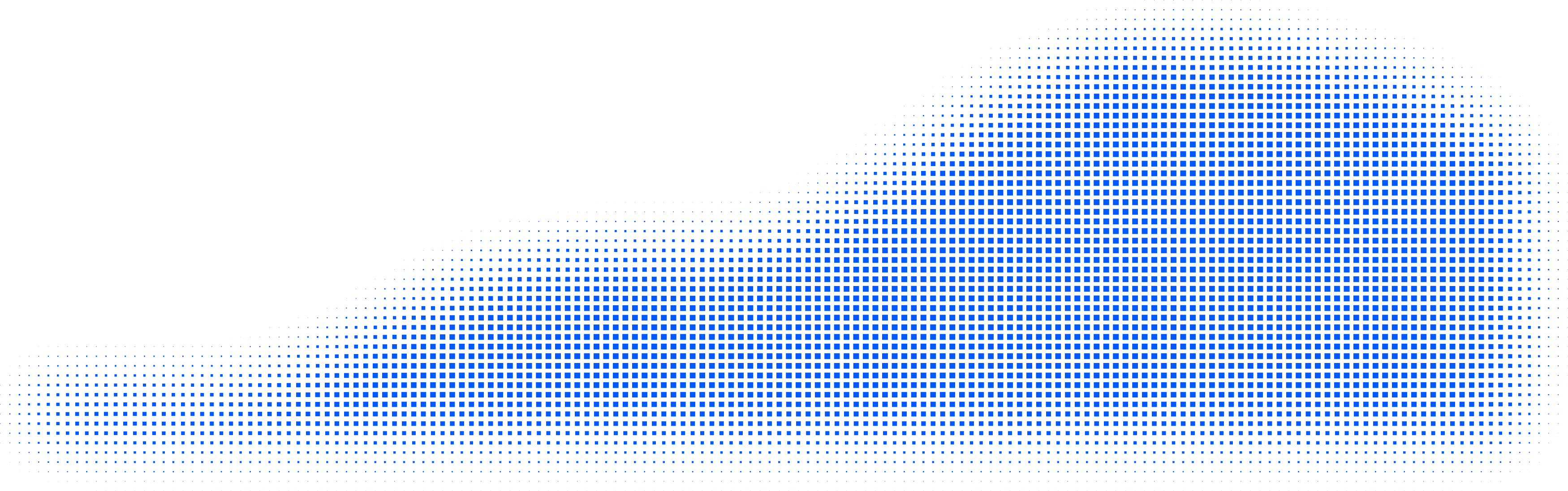1. Introduction
En tant que fournisseur de logiciels pour l'industrie minière, Deswik forme régulièrement des ingénieurs miniers à l'utilisation de notre logiciel pour la conception, la planification et la programmation des mines.
Nous sommes souvent appelés à former des ingénieurs juniors entamant leur premier rôle lié à la planification et nous constatons que nombre d'entre eux ont besoin de plus de connaissances sur les processus de planification et souhaitent en savoir plus sur les processus de planification, au-delà de la simple utilisation du logiciel fourni. L'une de ces exigences est la connaissance des modèles de blocs qui doivent être utilisés pour le processus de planification minière.
La rotation rapide du personnel au cours du dernier boom minier, puis la perte de personnel expérimenté et doté de compétences techniques au cours de la crise suivante, signifient que de nombreux ingénieurs juniors n'ont pas de mentor suffisamment qualifié à leurs côtés pour leur fournir une aide éclairée.
Dans cet esprit, ce document a été écrit pour initier les nouveaux ingénieurs miniers aux modèles de blocs de ressources minérales : leur structure, les marques qu'ils peuvent rencontrer, les types sur lesquels ils peuvent tomber et les problèmes qu'ils devront comprendre pour éviter les erreurs dans leur utilisation.
L'intention n'est pas de transformer les ingénieurs miniers en géologues des ressources, mais il est important qu'un ingénieur minier connaisse également les procédures d'estimation des ressources pour comprendre comment le modèle de blocs de ressources a été généré. Un modèle de blocs de ressources ne sera aussi bon que les fondations géologiques sur lesquelles il est construit.
Et comme le modèle de blocs de ressources est la base sur laquelle sont construits les plans miniers de l'industrie, nos plans ne seront jamais aussi bons que le modèle de blocs géologiques qui nous a été confié.
Ce document n'est qu'une première étape d'introduction aux connaissances nécessaires. Nous reconnaissons que, bien que le présent document ait pour objet d'être une introduction au sujet, il y a malgré tout beaucoup de choses qui ont été traitées. Nous invitons donc le lecteur à « plonger dans le contenu » là où cela est nécessaire et à sauter les parties qui ne sont pas encore pertinentes pour son travail. Nous encourageons également le nouvel ingénieur minier à en savoir plus sur l'estimation des ressources au-delà du présent document afin d'améliorer sa base de connaissances.
Bien que ce document ait pour objectif de présenter les modèles de blocs aux ingénieurs miniers afin qu'ils comprennent ce à quoi ils ont affaire et qu'ils ne commettent pas d'erreurs par manque de connaissances, il faut toujours garder à l'esprit que le modèle de blocs qui leur a été attribué peut ne pas être approprié au regard de la tâche à accomplir. Comme l'a déclaré Clive Johnson (président et PDG de B2Gold) en 2013 lors d'une table ronde de la conférence minière Scotiabank portant sur lacunes constatées dans les rapports NI 43-101 :
« Ce que l'on constate généralement là où la [valeur du projet] s'effondre, c'est au niveau du modèle de blocs. Nous vous disons simplement de nous donner vos données… c'est généralement là que cela échoue. L'extrapolation qu'ils utilisent pour leurs réserves et leurs ressources est probablement complètement décalée par rapport aux informations ou données géostatistiques existantes ».
Soyez donc prudents, mais faites preuve d'audace en tirant parti de vos connaissances.
2. Les bases
Un modèle de blocs est une représentation simplifiée d'un corps de minerai et de ses environs qui peut être considéré comme un empilement de « briques » générées par ordinateur qui représentent de petits volumes de roche dans un gisement (minerai et résidus). Chaque « brique », ou cellule, contient des estimations de données, telles que la teneur des éléments, la densité et d'autres valeurs d'entité géologique ou d'ingénierie.
Figure 1 : un modèle de blocs d'un corps de minerai coloré par teneur (enveloppe et tranche)
Les cellules d'un modèle de blocs sont agencées dans un système de grille XYZ et les cellules peuvent être de taille uniforme ou irrégulière.
Le logiciel Deswik n'effectue pas de classement des estimations pour la génération de modèles de blocs, mais permet d'interroger et de manipuler un modèle de blocs préparé par d'autres logiciels, tels que Leapfrog/Edge, Datamine, Vulcan, Surpac, MineSight et Micromine. Dans ces ensembles, les blocs sont notés par l'une des méthodes d'estimation suivantes : inverse de la distance au carré, krigeage ordinaire, krigeage à indicateurs multiples, etc.
Les sections suivantes expliquent plus précisément ces concepts.
2.1. CADRE DU MODÈLE
Le terme « cadre du modèle » définit la région rectangulaire de l'espace dans laquelle se trouvent les cellules du modèle. Il nécessite une origine, une distance pour chaque axe et un angle de rotation.
Figure 2 : cadre de modèle de blocs standard
Dans ce cadre, il y a des blocs individuels, tous avec une longueur (incrément X), une largeur (incrément Y) et une hauteur (incrément Z) désignées. La position du bloc peut être définie par un centroïde (Xc, Yc, Zc) ou une origine de bloc (Xmin, Ymin, Zmin).
Figure 3 : définition de blocs de modèle de blocs
Le nombre de blocs dans chaque direction de l'axe de coordonnées est généralement spécifié pour définir le cadre complet du modèle potentiel. Notez que certains schémas de modélisation ne nécessitent pas nécessairement un modèle de blocs entièrement « rempli » – des blocs peuvent être manquants ou absents dans le cadre.
Figure 4 : modèle de blocs remplis
Un dernier aspect important des modèles de blocs est de noter comment les blocs sont positionnés à l'origine. Il existe deux options, comme le montre la figure 5. Le format de blocs avec le « bloc d'origine » le long des axes (image de gauche dans la figure 5) est le plus courant, mais le « bloc d'origine » ayant son centroïde situé sur l'origine (image de droite dans la figure 5) doit être vérifié, car cela arrive parfois (noter qu'il s'agit de l'option par défaut dans les modèles Micromine).
Figure 5 : Relation entre le centroïde potentiel du bloc et l'origine
2.2. SOUS-DIVISION DE MODÈLE
Les premiers modèles développés ont partitionné l'espace total du modèle en un réseau tridimensionnel régulier de cuboïdes, comme le montre la figure 4.
Afin de mieux modéliser les limites dans l'espace du modèle, les blocs peuvent être subdivisés en tailles cuboïdes plus petites (ou prismes rectangulaires), appelées sous-blocs ou sous-cellules, tout en conservant l'efficacité de stockage et de calcul du modèle de blocs standard. Les sous-cellules sont généralement stockées séparément des blocs parents.
Figure 6 : Subdivision en sous-cellules d'un modèle de blocs le long d'une limite
Le processus de subdivision peut être effectué de deux manières : par subdivision en octree ou par subdivision flexible.
La subdivision en octree divise le bloc parent en une hiérarchie de cubes avec une subdivision automatique aux limites utilisées, de sorte que tous les blocs sont continuellement divisés par deux, ce qui donne des blocs avec des côtés de taille « x », « x/2 », « x/4 », « x/8 », … « x/2n », où « x » est la taille maximale des blocs d'origine (bloc parent) et « n » indique la quantité maximale de subdivisions à autoriser. C'est la méthode utilisée par Surpac.
La méthode flexible permet de varier la subdivision en fonction de l'angle d'intersection d'un bloc particulier, la surface de limite contrôlant la subdivision. La subdivision est variable à l'infini, ce qui permet une meilleure interprétation volumétrique de la surface des limites, ce qui produit moins de blocs pour le même niveau de précision par rapport à la méthode de l'octree. C'est la méthode utilisée par Datamine.
Surpac utilise la subdivision octree, tandis que Datamine utilise la méthode flexible ; il s'agit d'une cause majeure de problèmes d'incompatibilité entre les deux types de modèles. (Notez que Surpac dispose d'un format de « modèle de blocs libres » pour permettre l'importation et l'interrogation d'un modèle de Datamine.)
2.3. MODÈLES EN ROTATION
Certains systèmes de modélisation de blocs prennent en charge les modèles de blocs en rotation. Un modèle tourné est celui dont les axes, et donc les cellules, font l'objet d'un pivotement par rapport au système de coordonnées. Il est particulièrement utile dans les situations où un corps de minerai stratifié est en train de s'enfoncer ou de plonger. Les cellules du modèle fournissent un bien meilleur ajustement au corps de minerai lorsque le modèle est mis en rotation, comme le montrent les figures suivantes.
S'il s'agit de votre gisement de minerai indiqué à la figure 7 :
Figure 7 : Coupe transversale d'un corps de minerai en plongée oblique
Ensuite, un modèle normal de blocs orthogonaux normaux non mis en rotation donnerait des blocs de minerai ressemblant à ceux représentés à la figure 8.
Figure 8 : Coupe transversale d'un corps de minerai en plongée oblique avec des blocs non mis en rotation
Toutefois, si le modèle de blocs est mis en rotation, une bien meilleure représentation du corps de minerai est possible avec des blocs de minerai ressemblant à ceux représentés à la figure 9.
Figure 9 : Coupe transversale d'un corps de minerai en plongée oblique avec des blocs mis en rotation selon l'axe Z
Notez que dans les modèles de blocs Datamine, le modèle est stocké dans un format non mis en rotation qui est mis en rotation uniquement lors de l'affichage ou de l'interrogation.
Il est également important de noter que dans un modèle de blocs en rotation, les positions des centroïdes en rotation ne sont plus des valeurs de centroïdes simples et systématiques. Pour maintenir la précision dans les positions spatiales relatives des blocs lors de l'importation de modèles de blocs mis en rotation, les coordonnées du centroïde doivent être fournies avec une précision de huit ou neuf chiffres. La figure 10 montre deux vues des points d'intersection des blocs d'un modèle de blocs en rotation qui a été importé avec seulement deux décimales de précision. Le résultat est un modèle de blocs dans lequel les blocs se chevauchent ou présentent des lacunes (vides) entre eux.
Figure 10 : vue rapprochée des coins des blocs d'un modèle de blocs mis en rotation importé avec une précision décimale insuffisante
Si les données sont fournies pour un modèle de blocs en rotation avec une précision décimale limitée, il est possible (si le modèle est un modèle régulier et non un modèle de blocs à sous-cellules irréguliers) de arrêter mathématiquement la rotation du modèle, de corriger les centroïdes approximatifs non en rotation pour les amener à ce qui devrait être les centroïdes réels (par exemple, un centroïde non en rotation de xx2.498673 était probablement destiné à être xx2.500), puis de remettre en rotation les centroïdes corrigés dans un fichier prêt à être importé dans le logiciel.
3. « Marques » de modèles de blocs
Les types de modèles de blocs les plus courants dans l'industrie minière sont Datamine, Vulcan, Surpac, Micromine et MineSight.
Les modèles de format de données sont actuellement le meilleur format pour une utilisation dans Deswik, car ils sont pris en charge par des commandes complètes pour l'interrogation et les manipulations1. Dans ce contexte, nous avons discuté de ce format de fichier plus en détail que les autres.
Le format Datamine a été le format choisi pour Deswik lors des débuts de Deswik, car nous ne voulions pas inventer un autre format de modèle de blocs propriétaire, et la structure générale et le format des modèles Datamine étaient disponibles au public et donc bien connus. Par conséquent, de nombreux logiciels de modélisation géologique permettent d'exporter leurs modèles en tant que modèles Datamine. D'autres formats de modèles ont dû être déterminés par une interprétation judicieuse des essais et des erreurs s'agissant de la manière dont ils stockent leurs données.
Deswik prend en charge l'importation et la conversion directes des modèles Vulcan et Surpac en modèles au format Datamine. En outre, certaines fonctionnalités de base, telles que l'interrogation des solides dans Deswik.Sched, sont prises en charge pour les modèles Surpac et Vulcan dans leur format natif. Mais tout modèle nécessitant des calculs et des manipulations supplémentaires devra être inclus dans le
1 Un nouveau format de modèle de blocs est en cours de développement par Deswik pour surmonter bon nombre des limitations de taille, de vitesse et de stockage de Datamine, et devrait être disponible au début de 2019. Ce format de fichier sera conforme au format Open Mining Format (*.omf) recommandé par le Global Mining Guidelines Group (GMG).
format Datamine étant donné que la suite complète des commandes Deswik n'est prise en charge que pour les modèles Datamine (et bien sûr, pour le nouveau format de modèle de blocs 2019 en cours de développement).
Pour MineSight, Micromine et d'autres types de modèles non pris en charge, la meilleure solution pour importer dans Deswik est d'exporter directement les modèles de blocs à partir du logiciel d'origine sous forme de modèles au format Datamine. Ils peuvent également être exportés sous forme de fichiers CSV, qui peuvent ensuite être convertis en un modèle de format Datamine dans Deswik.
(Conseil : si vous importez un modèle de blocs mis en rotation à partir d'un fichier CSV, assurez-vous que les données X-Y-Z sont accompagnés d'une précision de neuf décimales, car un manque de précision décimale causera des problèmes).
3.1. DATAMINE
Les modèles de blocs de données seront reconnus par leur suffixe : *.dm.
Il existe deux limitations majeures des fichiers Datamine qu'il faut comprendre :
(a) Les fichiers Datamine ne prennent en charge que huit caractères en tant que noms de champs.
(b) Les fichiers Datamine sont limités à un total de 256 champs (s'ils sont au format de précision étendue par défaut).
Le format Datamine est enraciné dans une longue histoire. Datamine a été fondée en 1981 et utilise le système de gestion de bases de données relationnelles G-EXEC développé par le British Geological Survey au cours des années 1970.
Les fichiers Datamine sont des fichiers d'accès aléatoire stockés sous forme de tableaux plats, sans aucune relation hiérarchique ou de réseau implicite. La structure du modèle est définie dans un fichier de « prototype de modèle » et le contexte spatial de chaque bloc est stocké dans le cadre de l'enregistrement de chaque bloc à l'aide d'un positionnement implicite, ce qui permet d'économiser de l'espace de stockage et du temps de traitement. Pour cela, le code d'indexation ijk (voir Figures 11 et Figures 12) est utilisé, permettant un accès rapide au programme informatique à n'importe quelle partie du modèle.
Certains éléments mathématiques liés au code IJK sont les suivants :
IJK = NZ × NY × I + NZ × J + K
L'IJK peut également être déterminée à partir du système de coordonnées du modèle :
I = ROUND[ (Xc-XParentINC/2)/XParentINC]*XParentINC - XmORIG)/XParentINC
J = ROUND[ (Yc-YParentINC/2)/YParentINC]*YParentINC – YmORIG)/YParentINC
K = ROUND[ (Zc-ZParentINC/2)/ZParentINC]*ZParentINC - ZmORIG)/ZParentINC
Où XParentINC, YParentINC et ZParentINC sont les tailles X, Y et Z des blocs parents (vers toutes les sous-cellules).
La structure du prototype du modèle utilise les champs indiqués dans le tableau 1.
Tableau 1 : champs de structure de prototype de modèle de blocs Datamine
Figure 11 : schéma Datamine IJK
Figure 12 : schéma Datamine IJK
Il existe deux versions du format DM : précision unique (SP) et précision étendue (EP).
Le format DM original à précision unique était basé sur des « pages » de 2048 octets. (Il s'agit des enregistrements Fortran de 512 mots de × 4 octets). La première page contenait la définition des données, tandis que les pages suivantes contenaient les enregistrements de données.
Il existe deux types de données : le texte ou alpha ( « A » ) et le numérique à virgule flottante ( « N » ).
Les éléments des nombres entiers dans la page de définition des données sont stockés en tant que valeurs Fortran REAL*4 ou REAL*8 dans les formats de précision unique et étendue respectivement.
Il existe des codes numériques spéciaux qui sont utilisés dans les données.
- -1.0 E30 = "bottom"; utilisé comme code de données manquantes pour les champs numériques, également connu sous le nom de « valeur nulle ». (Pour les champs de texte, les données manquantes sont simplement toutes les zones vides.)
- +1.0 E30 = "top"; et est utilisé si une représentation de l' « infini » est nécessaire.
- +1.0 E-30 = "TR" ou "DL"; utilisé s'il est nécessaire de représenter une valeur d'analyse « trace » ou « inférieure à la limite de détection ».
Toutes les données textuelles sont conservées dans des variables de type REAL et non de type CHARACTER en Fortran, bien que le format stocké soit identique. Cela permet d'utiliser un simple tableau REAL pour contenir tout le tampon d'une page, et un autre tableau REAL pour contenir l'ensemble de chaque enregistrement logique pour l'écriture ou la lecture. Ce concept trouve son origine dans le système G-EXEC du British Geological Survey en 1972 et a été la clé de la généralité de Datamine, plutôt que de devoir prédéfinir des formats de données spécifiques pour chaque combinaison de champs textuels et numériques.
Le format de fichier Datamine à « précision étendue » (EP) a des pages ayant deux fois la taille du format de fichier « précision unique » - 4096 octets de long - et la structure des pages est simplement mappée en mots de 8 octets au lieu de 4 octets.
Le format de fichier Datamine « simple précision » est en fait un format hérité et, avec un peu de chance, il ne sera plus souvent rencontré. Ces fichiers ne peuvent avoir que 64 champs, tandis que les fichiers « double précision » peuvent avoir 256 champs. Si un fichier « simple précision » est rencontré, Deswik dispose d'une méthode pour le convertir en un fichier « double précision ». (Consultez les fichiers d'aide dans une telle situation.)
Le format de fichier EP Datamine permet l'utilisation complète du format Fortran REAL*8 (ou DOUBLE PRECISION) complet, mais pour les données textuelles, seuls les quatre premiers octets de chaque mot de double précision sont utilisés. La structure des fichiers EP est donc inefficace en termes de stockage de données pour les fichiers qui contiennent des quantités importantes de données textuelles.
Les modèles de blocs de données ont deux « niveaux » de blocs : les blocs parents et les blocs enfants (sous-blocs ou sous-cellules). Lorsqu'un modèle Datamine est créé, l'utilisateur spécifie la taille du bloc parent, qui sera constante pendant toute la durée de vie du modèle.
Au cours du processus de création d'un modèle de blocs Datamine, les sous-blocs sont créés le long des limites, afin qu'un bloc parent puisse avoir un nombre quelconque de blocs enfants, et ils peuvent être de n'importe quelle taille. Chaque bloc parent peut avoir un nombre différent de blocs enfants.
3.2. DATAMINE - UNICODE
Les modèles de blocs Datamine Unicode seront reconnus à leur suffixe : *.dmu.
L'une des limitations majeures du format de fichier Datamine est qu'il stocke tout le texte au format ASCII, ce qui pose problème lorsque vous essayez de travailler dans une langue symbolique telle que le russe, le polonais, le japonais, le chinois, etc. à
Afin de desservir les marchés non anglophones sur lesquels Deswik s'est implantée, il était nécessaire de permettre au format Datamine de prendre en charge « Unicode » (qui n'existait même pas lorsque le format Datamine a été inventé). Unicode est une norme comme l'ASCII, mais une norme beaucoup plus large et qui fournit un numéro unique pour chaque caractère, quelle que soit la langue.
Notez que ce format Unicode de Datamine n'est pris en charge par aucun autre logiciel autre que Deswik, mais il suit de près le format Datamine. En suivant le format Datamine pour cette modification, il a été possible de la mettre en œuvre sans modifier les routines ou les fonctions dont Deswik disposait déjà pour la manipulation des modèles Datamine.
Notez qu'un modèle de blocs *.dmu présente les caractéristiques suivantes :
(a) Il n'y a pas de limite pour la taille du nom du champ (auparavant huit caractères, il peut désormais comporter tout nombre de caractères).
(b) Il est possible de prendre en charge toutes les langues, directement encodées dans le fichier.
(c) Il existe toujours une limite stricte de 256 champs, mais désormais votre champ de texte ne compte que pour l'un de ces champs. Auparavant, si votre colonne de texte avait une largeur de 20, elle comptait comme cinq champs, ce qui vous permet d'intégrer plus de champs si vous utilisez du texte.
(d) Des longueurs de texte variables sont disponibles. Si vous aviez une colonne portant les lettres AAAA et AAAAAAAA, vous devriez définir à l'avance que la colonne a huit caractères. Désormais, peu importe le nombre de caractères (maximum ou minimum) présents dans une colonne.
L'auteur recommande de ne pas utiliser les fichiers *.dmu sauf si vous y êtes obligé. Comme les utilisateurs de *.dm sont beaucoup plus nombreux, les bogues logiciels liés aux modèles de blocs sont plus susceptibles d'être trouvés et corrigés pour les fichiers *.dm que pour les fichiers *.dmu.
3.3. SURPAC
Les modèles Standard de Surpac sont identifiables à leur suffixe : *.mdl.
Un format de modèle de blocs secondaire de Surpac est le « modèle de blocs libres », identifié par le suffixe *.fbm.
Surpac utilise la méthode de subdivision par octree, en d'autres termes. une méthode régulière de sous-blocage, de sorte que les blocs parents doivent être divisés en fractions de 1⁄2n, c.-à-d. 1⁄2 , 1⁄4 , 1⁄8 , etc. Le sous-blocage est défini lorsque vous créez le modèle. Toutefois, la division des blocs n'est pas effectuée avant qu'elle ne soit nécessaire. Cela signifie que le nombre de blocs est toujours le minimum possible.
Surpac a également le concept de « super-bloc » dans lequel les blocs identiques sont agglomérés jusqu'à ce qu'aucune agglomération ne puisse être effectuée ; cela signifie que la taille du modèle stocké d'un modèle de blocs Surpac peut être beaucoup plus petite qu'un modèle de blocs Datamine.
Les différents régimes de dimensionnement des sous-cellules signifient que de nombreux modèles Datamine ne peuvent pas être convertis en un modèle de blocs Surpac natif (mdl) en cas de sous-cellulage irrégulier. Surpac fournit le format « modèle de blocs libres » pour l'importation et la manipulation des modèles de blocs Datamine dans Surpac. (Mais même dans Surpac, cela limite ce qui peut être fait avec un tel
modèle).
Si on reçoit un modèle de blocs « *.fbm », il est préférable de retourner à la source et de voir si le modèle de blocs « *.dm » d'origine de Datamine peut être obtenu ou, si vous avez accès à Surpac, s'il peut être exporté sous forme de fichier « *.dm ». Sinon, vous pouvez organiser une exportation des données au format « *.csv » et convertir dans Deswik en un modèle Datamine.
À partir de mars 2018, Deswik prendra en charge un modèle de blocs libres « *.fbm ». Toutefois, ce qui peut être fait avec de tels modèles est limité.
Notez que les champs de Surpac peuvent également être de type « Calculate ». Ce type de champ n'est calculé que lorsqu'il est utilisé, à l'aide d'une équation qui remplit la colonne de description du champ. Encore une fois, à partir d'août 2018, Deswik prendra en charge les modèles Surpac qui utilisent des champs calculés (dans la version 2018.3.433 et les suivantes).
Bien que Deswik prenne en charge l'utilisation directe d'un modèle Surpac dans des outils tels que l'interrogation, l'affichage de tranches (et non l'affichage d'enveloppes), l'interrogation d'une cellule et la lecture pour l'outil de conception de fosse, l'ensemble de commandes disponibles pour l'utilisation et la manipulation est très limité. Il est donc recommandé de convertir les modèles Surpac au format Datamine, car cela permettra une plus grande flexibilité et une meilleure facilité d'utilisation dans Deswik.CAD, en permettant d'ajouter des champs utilisés dans la vérification des processus de modèle de blocs.
Lors de la conversion d'un modèle Surpac, notez que Surpac permet de construire des modèles dans l'un des quatre quadrants cartésiens (I, II, III et IV), comme le montre la figure 13, sans avoir à utiliser de coordonnées négatives. Pour importer un tel modèle dans un format Datamine, le logiciel Deswik fournit, au cours du processus d'importation, des options pour :
(a) Faire basculer les axes X-Y.
b) Multiplier X par « -1 ».
Les limitations de cette méthode sont les suivantes :
Figure 13 : quadrants cartésiens
Notez que Deswik ne prend pas en charge les modèles de blocs Surpac v1.0 ; les routines ont été construites à partir de l'interprétation des modèles Surpac v4.0. Ces modèles devront être importés à l'aide du processus d'importation « *.csv ».
3.4. VULCAN
Les modèles de blocs Vulcan peuvent être identifiés par le suffixe d'extension de fichier *.bmf. Il peut également y avoir un fichier *.bdf associé, qui est un fichier de définition de blocs (utilisé dans la création du modèle de blocs, mais qui n'est plus nécessaire une fois le modèle de blocs créé).
Il existe plusieurs versions du modèle de blocs Vulcan.
Le format original du modèle de blocs Vulcan (Classic) stockait toutes les données pour tous les blocs. Cela signifiait que si vous aviez un million de blocs avec la valeur par défaut, votre fichier de modèle de blocs avait écrit la valeur par défaut un million de fois. Il en a résulté un fichier de modèle très volumineux.
Le format « Extended » écrit toutes les informations par défaut dans l'en-tête, puis référence l'en-tête pour tous les blocs avec des valeurs par défaut. Cela signifie que le fichier de modèle de blocs écrira cette valeur dans l'en-tête une fois (et non pas un million de fois) si vous avez un million de blocs avec la valeur par défaut dans le format « Extended ». Cette méthode permet d'économiser une quantité importante d'espace de fichiers.
Deswik prend en charge la version bmf v6.0 des modèles de blocs Vulcan.
En ce qui concerne les modèles Surpac, les fonctionnalités des modèles Vulcan dans Deswik sont limitées ; ils peuvent être directement interrogés, affichés (découpage en tranches uniquement) et utilisés dans l'outil de conception de fosses.
Les fichiers de modèles de blocs ne peuvent toutefois pas être modifiés ni manipulés, et il n'existe pas de plans pour prendre en charge l'altération des modèles de blocs Vulcan.
Les types de données pour les modèles de blocs Vulcan sont les suivants :
- Nom : cela s'applique aux données de type chaîne (c.-à-d. domaines géologiques). Les données sont stockées dans le modèle de blocs en tant que données à nombres entiers, puis reconverties en valeurs de noms à l'aide d'une table de traduction.
- Octet : il s'agit d'une valeur entière comprise entre 0 et 255. Le type de variable d'octet occupe un octet de mémoire.
- Abrégé : il s'agit d'une valeur entière comprise entre -32 768 et +32 767 nécessitant deux octets de mémoire.
- Entier : ce type de données enregistre des valeurs entières comprises entre -1 milliard et +1 milliard. Il utilise quatre octets de mémoire.
- Flottement : il s'agit d'un nombre réel utilisant quatre octets de mémoire. Il peut stocker jusqu'à sept chiffres significatifs.
- Double : il s'agit d'un nombre réel utilisant huit octets de mémoire. Il peut stocker jusqu'à quatorze chiffres significatifs.
3.5. MINESIGHT
Un modèle de blocs MineSight aura généralement un suffixe *.dat (les fichiers de modèle de blocs Micromine utilisent également le suffixe *.dat). Notez que MineSight utilise le suffixe *.dat pour d'autres types de fichiers, tels que les données brutes de trous de forage et les fichiers de contrôle de projet.
Parmi les autres types de fichiers de MineSight, citons les suivants :
- *.srg (fichiers polyligne)
- *.msr (fichiers au format MineSight Resource), utilisés pour contenir des données d'objets de géométrie (chaînes, surfaces, solides).
Traditionnellement, les modèles de blocs de MineSight utilisaient un système de modélisation de blocs entiers (tailles de blocs fixes sans sous-division) avec des éléments du modèle identifiant les pourcentages du bloc dans les contacts du domaine géologique. La plupart des modèles MineSight rencontrés seront toujours de ce type. Cette approche a permis de modéliser de très grandes mines tout en respectant les limitations du passé en matière de mémoire de calcul et de stockage, ce qui l'a rendue populaire parmi les mines de grande taille (et pendant de nombreuses années, le seul moyen pour les grandes mines de couvrir l'ensemble de leur site était celui d'un modèle de blocs unique).
Depuis 2013, MineSight a proposé le sous-blocage (découpage en sous-cellules), qui génère un fichier supplémentaire associé au modèle de blocs 3D qui n'est appliqué qu'aux zones et aux éléments mis en sous-blocs.
3.6. GEMS
Les fichiers de modèles de blocs de Geovia GEMS auront le suffixe *.txt.
GEMS utilise une approche de modèle en pourcentage partiel sans division en sous-cellules.
Malheureusement, Deswik en sait très peu sur les fichiers GEMS.
3.7. MICROMINE
Un modèle de blocs Micromine portera le suffixe *.dat (identique à celui des fichiers MineSight).
Il peut être converti directement dans Deswik au format Datamine. À partir de la version 2018.4, le format étendu (avec mise en rotation) sera également pris en charge. (En novembre 2018, un bogue était en cours de correction).
Aucun outil n'est fourni pour utiliser un fichier de modèle de blocs Micromine directement dans Deswik ; ils doivent être convertis au format Datamine.
4. Types de modèles de blocs
La plupart des types de modèles de blocs diffèrent par:
a. La manière dont les échantillons analysés sont utilisés pour remplir les blocs (en d'autres termes, la manière dont les teneurs d'échantillons sont interpolées/extrapolées dans un bloc).
b. Comment les estimations dans un bloc sont présentées.
c. Comment les blocs sont physiquement construits ou représentés.
En ce qui concerne la façon dont les échantillons sont utilisés pour peupler les blocs, tous les modèles de blocs utilisent les données d'échantillon environnantes pour obtenir une estimation de chaque bloc, comme le montre schématiquement la figure 14. La pondération (λ dans la figure 15) et la moyenne de ces échantillons environnants constituent la base des différences entre les modèles discutés dans la section suivante.
Figure 14 : schéma de l'estimation des échantillons dans un bloc
Figure 15 : poids d'échantillons pour quatre points échantillonnés situés autour du point xo où a lieu l'estimation
4.1. MODÈLES À DISTANCE INVERSE
Les modèles à distance inverse pondérée (IDW) sont l'un des modèles les plus anciens et les plus simples sur le marché. Certains géologues les utilisent toujours, généralement lorsqu'il y a un effet pépite élevé et que les variogrammes sont difficiles à déterminer. Ils l'utilisent également pour le comparer à l'une des autres méthodes « d'ordre supérieur » afin de s'assurer que rien ne s'est égaré avec ces méthodes, car les résultats globaux devraient toujours être similaires : ±5 % environ.
La logique à l'origine du modèle IDW est que les échantillons plus proches sont plus proches de la teneur du bloc que les échantillons plus éloignés. Les échantillons plus proches reçoivent donc plus de pondération et sont pondérés par un facteur inverse de la distance, généralement, mais pas toujours, à une puissance de deux (distance carrée inverse) ou trois (distance cube inverse).
L'inverse des distances de séparation est rééchelonné, de sorte qu'elles s'additionnent pour n'en former qu'une, ce qui garantit que la teneur estimée est non biaisée par rapport aux teneurs d'échantillon.
4.2. MODÈLES DE STOCKAGE ORDINAIRES
Ordinary Kriging (OK) a été développé par Danie Krige (un ingénieur minier sud-africain) et Georges Matheron (un ingénieur français).
L'une des principales caractéristiques de la méthode OK est qu'elle utilise toute corrélation spatiale pouvant exister entre les points d'échantillonnage pour peser les effets des points d'échantillonnage sur un point de prédiction. Les poids sont générés par le « variogramme » pour le domaine géologique du bloc à estimer. Il s'agit essentiellement d'une approche de régression spatiale visant à obtenir la « meilleure » pondération à appliquer aux échantillons alimentant l'estimation par blocs.
Le variogramme est la fonction statistique qui décrit la variabilité spatiale d'une mesure (par exemple, les niveaux) et est calculée à l'aide d'une mesure de variabilité entre des paires de points à différentes distances les uns des autres.
Lorsque nous analysons des paires d'échantillons séparées par une distance spécifique, nous constatons généralement qu'à des distances plus petites, les différences entre ces paires d'échantillons sont moindres que lorsque les échantillons sont plus éloignés les uns des autres. Les teneurs des paires d'échantillons sont liées les unes aux autres et l'intensité de cette relation varie avec la distance entre les échantillons.
Le variogramme résultant décrit la variabilité entre les points en fonction de la distance.
Il est courant de constater que la nature de la variabilité varie selon la direction.
Ce processus de calcul et d'utilisation du variogramme étant des statistiques dans un cadre géospatial, il est appelé « géostatistique ».
La méthode OK a également été développée pour tenir compte de l'effet de la variance du volume. L'effet de la variance du volume décrit l'augmentation de la dilution de la teneur à mesure que nous sélectionnons de plus grands volumes ; les blocs à haute teneur estimés ont une teneur inférieure à celle prévue et les blocs à faible teneur estimés ont une teneur supérieure à celle prévue. En outre, plus le volume est important, plus la variabilité des teneurs est faible (différences entre les teneurs les plus élevées et les plus basses réparties dans le gisement).
L'effet de la variance du volume a pour conséquence d'ajuster les estimations pour tenir compte des volumes qui seront extraits lors de l'établissement d'un modèle de ressources avec un critère de sélectivité appliqué (par exemple, une teneur seuil).
En résumé, la méthode OK répond à deux conditions :
- Différence globale minimale entre la teneur prévue et la teneur réelle,
- Estimation non biaisée (la somme des poids d'échantillonnage est égale à un).
Si le modèle de variogramme est approprié, OK sera plus performante que IDW, car l'estimation sera lissée de manière conditionnée par la variabilité spatiale des données (connue à partir du variogramme).
4.3. MÉTHODES LINÉAIRES ET MÉTHODES NON LINÉAIRES
Le krigeage ordinaire et la pondération inverse de la distance sont des méthodes d'estimation « linéaires ». Une méthode d'interpolation linéaire est une méthode dans laquelle les poids affectés à chacun des N emplacements d'échantillonnage à l'intérieur du voisinage d'estimation sont indépendants des valeurs de données spécifiques à ces emplacements.
Les estimateurs géostatistiques non linéaires se distinguent des estimateurs linéaires en ce qu'ils attribuent des pondérations aux échantillons qui sont des fonctions des teneurs elles-mêmes ; en d'autres termes, ils ne dépendent pas uniquement de l'emplacement des données. Une méthode non linéaire tentera d'estimer la proportion de petits blocs ou d'« unités minières sélectives » (SMU) qui dépassent une valeur seuil donnée dans un bloc (ou « panneau » ) plus grand.
Dans les situations où seuls des forages à grands espacements sont possibles, des techniques d'estimation linéaire correctement mises en œuvre permettent généralement de produire des relations de tonnage sur-lissées par rapport aux estimations de production finales (et à la production elle-même) (De-Vitry, Vann et Arvidson, 2007). Cela conduit à des prévisions localement imprécises des tonnes récupérables et à une teneur supérieure à une teneur limite. Le lissage est en partie fonction de la densité de forage, mais dépend également de la taille des blocs, de la distance de recherche, du type et des paramètres du variogramme.
Le lissage excessif dans un modèle OK est normalement contrôlé en réduisant le nombre maximal de composites (c.-à-d. des échantillons agrégés sur un trou de forage) utilisés dans l'estimation d'un bloc, au point où OK n'est plus un bon estimateur local et devient de plus en plus « biaisé conditionnellement ». Les modèles résultants sont généralement un compromis entre une distribution globale de SMU souhaitée et l'utilisation de suffisamment de composites pour garantir une bonne estimation locale.
En outre, lorsqu'il est question d'une distribution d'échantillons fortement asymétrique, par exemple de nombreux gisements d'or, d'étain et d'uranium, l'estimation de la moyenne à l'aide d'un estimateur linéaire (par exemple par OK) est risquée. En effet, les pondérations ne dépendant pas des teneurs d'échantillonnage, la présence de valeurs extrêmes peut rendre toute estimation linéaire très instable.
Selon la littérature sur la modélisation par blocs (par exemple Caers, 2000 ; Journal, Kyriakidis et Mao, 2000), il est mathématiquement impossible d'obtenir une carte d'estimation unique (estimation linéaire) précise à la fois localement et globalement. Lorsque le lissage de l'estimation est trop élevé, il est généralement considéré qu'une méthode non linéaire pourrait permettre de donner une meilleure estimation.
Lors de l'utilisation d'une estimation non linéaire pour l'estimation des ressources récupérables dans une mine, les panneaux (bloc parent) doivent généralement avoir des dimensions à peu près égales à l'espacement de forage, et ce n'est que dans de rares circonstances (en d'autres termes, avec une forte continuité) que des panneaux beaucoup plus petits peuvent être spécifiés.
Un certain nombre de méthodes non linéaires sont actuellement utilisées dans l'industrie minière. Il s'agit notamment de :
- Krigeage disjonctif (DK) (Matheron, 1976 ; Armstrong et Matheron, 1986a, 1986b) ;
- Krigeage indicatif (IK) (Journel, 1982, 1988) et variantes (krigeage à indicateurs multiples (MIK), krigeage à indicateur médian, etc.)
- Krigeage probabiliste (PK) (Verly et Sullivan, 1985) ;
- Krigeage lognormal (LK) (Dowd, 1982) et sa généralisation aux distributions non lognormales ; krigeage multigaussien (MK) (Verly, 1983) ;
- Conditionnement uniforme (UC) (Rivoirard, 1994) ;
- Indicateur de krigeage résiduel (RIK) (Rivoirard, 1989).
Dans la pratique de l'industrie commerciale, la méthode MIK est la plus courante des méthodes d'estimation non linéaire, bien qu'un modèle UC puisse être rencontré.
Il convient de noter qu'un certain nombre de praticiens estiment que les méthodes non linéaires ne peuvent pas conduire à des estimations qui peuvent être considérées comme mesurées dans le code JORC (2012), en raison de l'incertitude de l'emplacement des blocs de minerai de taille SMU au sein d'un panel d'estimation. Bien que la décision d'utiliser une estimation non linéaire résulte souvent d'un manque de connaissance des limites géologiques au sein d'un panel, cela peut ou non avoir un impact sur l'estimation du tonnage global de minerai lorsque l'on tient compte de la taille du panneau avec l'échelle de production de la mine. Il appartient à la personne compétente d'évaluer cette question, mais elle devrait être une considération supplémentaire délibérée dans le processus d'évaluation.
4.4. LES MODÈLES DE KRIGEAGE À INDICATEURS MULTIPLES (MIK)
MIK est la plus courante des techniques de modélisation des ressources non linéaires utilisées. Il sera discuté en détail ici, car il s'agit d'un modèle plus difficile à utiliser qu'un modèle ordinaire de krigeage, simple à utiliser et à interpréter, et que vos collègues sont susceptibles de connaître.
L'estimation MIK résulte en un modèle de ressources où chaque bloc de l'estimation a une estimation probabiliste du tonnage et de la teneur, qui est présentée sous forme de proportion de tonnage attendu et d'une teneur attendue supérieure à un certain nombre de valeurs seuils (ou « indicateur » ) pour chaque bloc. C'est comme si on disposait d'une courbe de tonnage disponible pour chaque bloc du modèle, comme le montre la figure 16.
Figure 16 : exemple de distribution du tonnage du modèle MIK pour un seul bloc
Tableau 2 (sous-ensemble de trois valeurs à partir d'un ensemble complet de généralement 10 à
15 valeurs).
Tableau 2 : exemple de sous-ensemble de valeurs d'indicateurs, de proportions et de teneurs
La distribution de l'indicateur est généralement fournie telle qu'elle a été déterminée, sous la forme d'une courbe de tonnage cumulé, qui est généralement appelée CCDF, ou d'une fonction de distribution cumulative conditionnelle.
Les valeurs des indicateurs (seuils de coupure pour la distribution dans chaque bloc) sont souvent à intervalles réguliers de teneur, mais se rapprochent dans les parties supérieures de teneur. Certains praticiens déclarent que les indicateurs doivent être choisis pour donner approximativement la même quantité de métal dans chacun des intervalles de classes d'indicateurs, tandis que d'autres ont choisi des indicateurs qui correspondent à diverses teneurs de coupure d'intérêt.
Le modèle est produit en imposant à l'estimation de chaque bloc une distribution d'incertitude autour de l'estimation, basée sur une approximation de la distribution des teneurs d'échantillonnage dans le voisinage de chaque bloc.
La variance du modèle est ensuite ajustée en fonction d'une correction de la variance du volume (également appelée correction du « changement de support » ). Cela produit une approximation de la distribution des teneurs à l'échelle de la SMU choisie, la SMU étant considérée comme étant une unité minière pratique minimale.
Étant donné que la variance des teneurs des blocs de taille SMU est largement inférieure à la variance des teneurs des petits échantillons de forage dont provient l'estimation initiale, la correction de support comprime la distribution, comme le montre la figure 17. Dans la pratique, nous constatons que l'histogramme des échantillons a généralement une « queue » beaucoup plus longue que l'histogramme des blocs miniers.
Figure 17 : exemple de compression de la distribution des teneurs pour les échantillons bruts aux échantillons de SMU
À la suite de la correction de support, la partie de la distribution au-dessus d'une teneur de coupure sélectionnée change ; en particulier, le tonnage au-dessus de la teneur de coupure (qui est généralement bien au-dessus ou à droite de la valeur modale) sera beaucoup plus réduit pour la distribution de SMU par rapport à la distribution d'échantillonnage d'analyse d'origine. Ainsi, la courbe de tonnage-teneur est en grande partie une fonction du support choisi par le géologue qui a construit le modèle. (Notez que cela peut être fait avant toute décision de la part de l'ingénieur minier concernant l'échelle probable de l'exploitation minière et la taille de l'équipement).
Dans la littérature sur la modélisation des MIK, cette modification du tonnage et de la teneur au-dessus d'une teneur de coupure est souvent prise en compte pour refléter l'impact de la perte de minerai, de la dilution et de la récupération minière attendue, de sorte que ceux-ci sont intégrés dans les estimations de la ressource pour les blocs de la taille de SMU sélectionnée. Toutefois, il convient de noter que ce n'est pas le cas pour toutes les sources de dilution et de perte (uniquement celles liées à la distribution géologique au sein de la SMU modélisée) (Bertinshaw et Lipton, 2007).
MIK est utile lorsqu'un gisement a des populations spatialement intégrées (par exemple, des structures transversales avec plusieurs phases de minéralisation). Il s'agit d'une méthode généralement utilisée lorsque le forage n'est pas pratique ou possible, ou lorsque la densité de forage est insuffisante pour décrire les caractéristiques géologiques en détail. Toutefois, Coombes (2008) soutient que la MIK « ne devrait JAMAIS être utilisée à la place d'une bonne interprétation géologique et d'un découpage en domaines approprié ».
4.4.1. LA TERMINOLOGIE MIK QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE
Panneaux :
L'unité de base d'un modèle de blocs MIK est un panneau qui a normalement les dimensions de l'espacement moyen des trous de forage dans le plan horizontal.
Le panneau doit être suffisamment grand pour contenir un nombre raisonnable de blocs ou de SMU (environ 15).
SMU (Selective Mining Units ou unités minières sélectives)
La SMU est le plus petit volume de roche qui peut être extrait séparément en tant que minerai ou résidu et est généralement défini par une largeur minimale d'exploitation minière.
En tant qu'utilisateur du modèle de blocs, savoir quelle SMU le géologue a utilisée. Par exemple, l'auteur a constaté que des modèles utilisaient des valeurs Z inférieures à la hauteur de la banquette, lorsque la mine est toujours exploitée à hauteur complète de le banquette. Cela garantit des résultats incorrects si le modèle est utilisé sans post-traitement supplémentaire du modèle par l'ingénieur minier.
La SMU est généralement beaucoup plus petite que les dimensions de la grille d'échantillonnage, en particulier aux stades de l'exploration/étude de faisabilité.
Assistance
Le support est un terme utilisé en géostatistique pour désigner le volume sur lequel les valeurs moyennes peuvent être calculées ou mesurées. Lorsqu'il y a un grand effet pépite ou (de manière équivalente) une structure importante à courte portée, l'impact du changement de support sera prononcé.
Type E
La teneur de type E est la teneur moyenne du panneau (résidus compris) et est obtenue à partir de la combinaison de toutes les teneurs par classe et de leurs proportions : la somme des proportions multipliée par la teneur moyenne de l'échantillon. (Notez que la teneur de type E n'est pas nécessairemente égal à la teneur moyenne de l'indicateur « zéro », car la teneur de type E est calculée avant le changement des modifications du support.)
4.4.2. QUAND VOUS POURRIEZ VOIR LE MODÈLE MIK UTILISÉ
Les modèles MIK sont raisonnablement courants pour les mines d'or exploitées par des sociétés australiennes. Ils ont également été adoptés par Newmont dans sa plateforme logicielle interne, à partir de 1988 pour ses mines nord-américaines (or).
Les méthodes d'indicateurs sont connues pour résoudre le problème de l'estimation des teneurs extrêmes plus efficacement que les méthodes linéaires traditionnelles, telles que OK. Ces modèles sont donc utilisés dans des gisements où les échantillons de teneurs montrent la propriété de variation extrême et, par conséquent, où les estimations de teneurs montrent une sensibilité extrême à un petit nombre de teneurs très élevées. Par conséquent, ils sont utilisés dans de nombreuses opérations minières du secteur aurifère.
Une liste globale des situations dans lesquelles vous pouvez voir un modèle MIK concerne les styles de minéralisation caractérisés par :
- Mauvaise définition des limites
- Variabilité élevée
- Continuité de faible teneur
- La présence de valeurs extrêmes
- La présence de populations multiples.
4.4.3. CERTAINS PROBLÈMES ET LIMITATIONS IMPORTANTS AVEC MIK
Il existe plusieurs problèmes connus avec les modèles MIK :
1. Difficultés de visualisation
Contrairement à un modèle OK, un modèle MIK ne peut pas être tracé avec une seule teneur sur un bloc pour la comparaison avec le forage (sauf pour la valeur de teneur de type E).
Les géostatisticiens et les géologues ont donc du mal à valider visuellement les estimations de la méthode MIK et doivent s'appuyer presque exclusivement sur des validations statistiques.
2. Emplacement inconnu du minerai dans un panneau
Les proportions dans la fonction de distribution cumulative conditionnelle (la courbe de tonnage/teneur pour chaque bloc) sont des probabilités. Les proportions ne nous indiquent pas où le minerai sera extrait dans le panneau. Cela nous indique simplement la proportion.
Un contrôle des teneurs est nécessaire pour localiser cette proportion. Ainsi, en général, les modèles MIK ne sont pas particulièrement utiles pour la planification des opérations souterraines sélectives et ont tendance à se limiter aux opérations à ciel ouvert en vrac à grande échelle et à faible teneur.
Il y a également une hypothèse de « sélection libre » au sein d'un panneau, c'est-à-dire que toutes les SMU au-dessus d'une teneur de coupure peuvent être exploitées, quel que soit leur emplacement relatif. Ce n'est pas nécessairement vrai ; il y aura probablement des situations où des blocs isolés de taille SMU finiront en tant que stériles (et inversement, des blocs de stériles isolés de taille SMU inclus dans le minerai).
3. Des proportions inférieures à celles de la taille d'une SMU
Bien que les méthodes MIK soient censées appliquer un « changement de support » à la taille d'une SMU, vous trouverez presque toujours des proportions d'indicateurs (en particulier les niveaux supérieurs) qui impliquent une proportion de volume supérieure à une teneur de coupure inférieure à la taille de SMU utilisée.
Cela nécessite un post-traitement avant l'utilisation du modèle. Il est recommandé de réduire ces proportions à zéro avant utilisation afin d'éviter l'accumulation de petits tonnages effectivement non récupérables en tonnages « récupérables » sur des volumes plus importants, tels que des banquettes ou des domaines. Ces petites proportions ne sont pas exploitables en pratique.
Par exemple, pour un panneau de 20 m × 20 m × 10 m (4 000 m3), avec une taille de SMU de 5 m × 8 m × 10 m (400 m3 ou 10 % du panneau), si les indicateurs sont tels que présentés dans le tableau 3, on peut constater qu'il existe deux indicateurs ( « 1.1 » et « 1.2 » ) pour lesquels la proportion au-dessus de l'indicateur est inférieure à celle d'un bloc de taille SMU.
Tableau 3 : exemple de sous-ensemble de valeurs d'indicateur, de proportions et de teneurs, avec une taille inférieure à une SMU au-*dessus de certains indicateurs supérieurs
La correction recommandée pour supprimer les proportions de taille inférieure à une SMU est indiquée ci-dessous dans le tableau 4. Cette correction a effectivement entraîné une « perte » si la teneur de coupure du minerai s'est avérée être de 1,1 g/t. Si la teneur de minerai est par exemple de 0,9 g/t, aucun changement effectif dans le tonnage de minerai ne sera remarqué (pour ce bloc particulier).
Tableau 4 : exemple de sous-ensemble de valeurs d'indicateur, de proportions et de teneurs, ajustés de manière à ce qu'aucune proportion d'indicateur ne soit inférieure à une taille de SMU
Des problèmes similaires peuvent survenir aux valeurs inférieures des indicateurs, avec des stériles « non récupérables » inférieurs à la taille d'une SMU qui seront en fait extraits sous forme de dilution avec le minerai. Si le volume de stériles (en dessous d'une valeur d'indicateur de coupure) est inférieur à la taille d'une SMU (comme pour l'indicateur de 0,50 g/t dans le tableau 5), ajoutez ces stériles dans cette classe d'indicateur et fixez la proportion et la teneur de la même manière que pour l'ensemble du panneau (tableau 6).
Tableau 5 : exemple de sous-ensemble de valeurs d'indiccateur, de proportions et de teneurs, avec moins d'une taille de SMU inférieure à un indicateur
Tableau 6 : exemple de sous-ensemble de valeurs d'indicateur, de proportions et de teneurs, avec moins d'une taille de SMU inférieure à un indicateur, ajusté de manière à ce qu'aucune proportion d'indicateur ne soit inférieure à une taille de SMU
4. Problèmes de relation d'ordre
Les modèles MIK utilisent des variogrammes différents pour chaque valeur d'indicateur, de sorte que les variogrammes peuvent parfois être inconsistants d'un seuil de coupure à un autre. Cela peut entraîner des blocs dans le modèle MIK pour lesquels une quantité plus importante de métal a été estimée au-dessus d'une valeur d'indicateur plus élevée qu'au-dessus d'une valeur d'indicateur plus basse.
Cela ne peut bien sûr pas se produire physiquement : à mesure que les teneurs de coupure augmentent, le métal contenu doit diminuer. Un tel problème est appelé problème de « relation d'ordre ».
Il y a trois conditions de cohérence qui doivent être respectées par le ccdf pour chaque bloc :
- La proportion ne devrait pas augmenter avec l'augmentation du seuil de coupure de l'indicateur.
Par exemple, si la proportion à 0,5 g/t est de 0,6, la proportion à 0,6 g/t ne peut pas être de 0,65.
- Le métal contenu ne devrait pas augmenter avec l'augmentation du seuil de coupure de l'indicateur.
Par exemple, pour un panneau de 4 000 m3 et une densité de 2,7, si la proportion et la teneur à l'indicateur de 0,5 g/t sont de 0,6 et de 0,9 g/t (donnant un métal contenu au-dessus du seuil de coupure de 0,5 g/t de 5 832 grammes), la proportion et la teneur à l'indicateur de 0,6 g/t ne peuvent pas être de 0,55 et de 0,99 g/t, car cela donnerait un métal contenu au-dessus du seuil de coupure de 0,6 g/t de 5 881 grammes, ce qui est supérieur au métal au-dessus de l'indicateur de valeur de coupure inférieure.
- Les teneurs d'incréments doivent se situer dans les limites de coupure de l'indicateur
Par exemple, si vous faites les calculs mathématiques pour la teneur du matériau entre deux valeurs d'indicateur, par exemple 0,5 et 0,6, la teneur du matériau dans cette classe d'indicateur doit être comprise entre 0,5 et 0,6 ; elle ne peut pas, par exemple, être 0,61.
Les problèmes de relation d'ordre doivent être vérifiés lorsqu'un modèle est livré. Ne vous contentez pas de supposer que tout a été fait correctement par le géologue qui l'a procuré. (Ce n'est souvent pas le cas.)
La plupart des programmes MIK commerciaux et du domaine public corrigent les problèmes de relation d'ordre en lissant le vecteur tonnage-teneur d'un panneau s'ils ne respectent pas les relations d'ordre.
Si vous découvrez des problèmes de relation d'ordre, transmettez le modèle au géologue. Si les problèmes sont mineurs, le géologue peut les résoudre en les lissant (à l'aide d'une fonction d'estimation moyenne, et non d'un processus d'ajustement à la hausse ou à la baisse). Si les problèmes de relation d'ordre sont nombreux, cela indique qu'il existe une distorsion inhérente de la relation entre la teneur et le tonnage estimée par le modèle MIK utilisé, et qu'il existe un problème dans la méthode MIK utilisée.
5. Modification de la méthode de support inappropriée
Le changement de support n'est pas « intégré » dans les logiciels MIK. Le modélisateur doit sélectionner une méthode appropriée.
Historiquement, il existe plusieurs méthodes utilisées pour le changement de support (sans entrer dans les mathématiques) appelées :
- Affine
- Lognormal
- Lognormal indirect
- Gaussien
- Simulation conditionnelle
Les méthodes diffèrent principalement par la façon dont elles traitent le caractère asymétrique des données. (Les corrections Affine conservent le même coefficient d'asymétrie que les données brutes. La correction Gaussienne élimine toute asymétrie pour produire une distribution normale (ou gaussienne) ; les autres font quelque chose entre ces deux extrêmes. Les différentes méthodes peuvent facilement entraîner une distribution différente, ce qui pose le problème de savoir quelle méthode utiliser pour obtenir un résultat « correct ».
Toutes les méthodes présentent des points communs majeurs :
- Elles laissent la moyenne inchangée.
- Elles appliquent un ajustement de la variance.
- La distribution des blocs résultante doit être moins sélective (appelée « relation de Cartier »).
Il est à noter que les corrections Affine sont peut-être les plus utilisées, mais ne sont plus considérées comme appropriées. Bien qu'elles réduisent la variance, elles ne corrigent pas l'asymétrie de la distribution. La forme de la distribution des SMU est identique à celle des échantillons. Dans les situations de forte asymétrie (effet pépite élevé ou structure à courte échelle prononcée dans le variogramme des teneurs), ces modèles corrigés en fonction du support présentent des résultats particulièrement mauvais (Vann, 2005).
En revanche, le bien-fondé des corrections lognormales directes ou indirectes dépend très fortement de la distribution ; la simulation conditionnelle est souvent perçue comme trop complexe et coûteuse en temps, et les méthodes gaussiennes (qui supposent une distribution normale - correction totale de l'asymétrie de la distribution des données brutes pour qu'elle soit symétrique) ne sont probablement vraies que pour les situations où l'effet pépite est très élevé (Vann, 2005).
Quelle que soit la méthode utilisée, rien ne garantit que les corrections appliquées au niveau local soient compatibles avec le même type de correction appliqué au niveau global.
6. Taille de SMU incorrecte pour la planification de la mine
La taille de la SMU sélectionnée par le géologue pour le modèle de ressources peut ne pas ressembler à la taille de la SMU choisie par l'ingénieur minier.
Cela nécessitera une forme de modification si elle est envisagée, sinon le modèle devra être renvoyé au géologue pour générer un nouveau modèle de blocs avec la nouvelle SMU sélectionnée.
7. Difficultés pratiques dans l'utilisation
L'un des problèmes majeurs des modèles MIK est l'aspect pratique de leur utilisation. Ils sont plus complexes à utiliser comme entrée pour l'optimisation des mines à ciel ouvert, la planification des mines ou la conception détaillée des mines, car chaque bloc contient une approximation de la distribution locale des teneurs et l'emplacement exact des limites du minerai n'est pas spécifié par le modèle.
Les ingénieurs miniers convertissent généralement le modèle en un modèle plus simple avec une seule teneur, ou au moins un modèle partiel avec une teneur de coupure prédéfinie.
En outre, le seuil de coupure spécifique nécessaire à la planification minière peut ne pas s'aligner sur les valeurs de l'indicateur, ce qui nécessite une interpolation pour être utilisé.
8. Problèmes liés à des éléments multiples non corrélés
La méthode MIK n'est pas non plus idéalement adaptée aux gisements où plusieurs éléments importants de revenus ou de pénalités doivent être modélisés, car la technique ne modélisera que la distribution d'une seule variable. À moins que toutes les variables ne soient fortement corrélées, il n'est pas possible d'évaluer une deuxième ou une troisième variable par rapport à une teneur de coupure spécifiée pour la variable primaire (Bertinshaw et Lipton, 2007).
Cela peut poser problème dans les mines d'or à forte teneur en argent et dans les mines de cuivre à forte teneur en or.
En outre, cette limitation rend les modèles MIK mal adaptés aux gisements de minerai de fer qui nécessitent généralement une estimation de variables, notamment Fe, SiO2 et P, ainsi qu'aux gisements de bauxite qui nécessitent l'estimation d'Al2O3 et de SiO2.
9. Valeur moyenne vs valeur médiane de l'indicateur supérieur
La teneur dans la dernière classe d'indicateurs (la classe supérieure) peut avoir un effet considérable sur le métal global dans l'estimation. Pour limiter l'effet des écarts extrêmes sur la teneur estimée pour la classe supérieure, il est courant d'utiliser la médiane plutôt que la teneur moyenne pour la classe supérieure d'indicateurs, ou d'utiliser une moyenne tronquée (avec une valeur limite d'échantillonnage supérieure), ou une valeur correspondant à un ajustement hyperbolique ou exponentiel appliqué aux données de la classe supérieure. Les conséquences de ce choix, souvent arbitraire, peuvent être très importantes et ont un impact fort sur l'estimation des zones les plus riches du corps de minerai (qui peut ou non refléter la réalité).
4.4.4. COMMENT UTILISER LES MODÈLES MIK DANS LES INTERROGATIONS
La façon la plus courante d'utiliser les modèles MIK est de calculer le tonnage et le métal dans les « classes » d'intérêt : en convertissant les facteurs MIK de tonnage et de teneur à partir de fractions supérieures à une teneur en tonnes et en métal entre les teneurs indicatrices (et à partir de ces deux chiffres, la teneur de chaque classe peut être calculée).
Cela devrait être fait en premier, pour chaque classe de teneur et pour chaque bloc, afin de vérifier les problèmes de relation d'ordre.
En outre, procédez comme suit avant d'utiliser le modèle :
- Apportez les ajustements « moins d'une SMU » à la CCDF pour chaque bloc pour la partie supérieure du minerai et la partie inférieure des stériles.
- Apportez des ajustements de dilution/perte, bien que cela puisse être appliqué aux classes de teneurs après interrogation.
Un exemple de calcul des tonnes et de la teneur pour les intervalles de minerai est donné ci-dessous à l'aide d'une CCDF indicatrice MIK générique figurant dans le tableau 7.
Tableau 7 : tableau des indicateurs MIK génériques
Si nous supposons les valeurs seuils suivantes :
Stériles/seuil de coupure de faible teneur = i5
Seuil de coupure de basse teneur/moyenne teneur= i8
Seuil de coupure à teneur moyenne/élevée= i10
Si le volume du panneau = Vol et la densité apparente du panneau in situ = SG, le tonnage et le métal des trois classes de minerai sont les suivants :
Faible teneur :
tonnes de faible teneur = p5 × Vol × SG - p8 × Vol × SG
métal de faible teneur = p5 × g5 × Vol × SG - p8 × g8 × Vol × SG
teneur de faible qualité = métal de faible teneur/tonnes de faible teneur
Teneur moyenne :
tonnes de teneur moyenne = p8 × Vol × SG - p10 × Vol × SG
métal de teneur moyenne = p8 × g8 × Vol × SG - p10 × g10 × Vol × SG
teneur de moyenne qualité = métal de moyenne teneur/tonnes de moyenne teneur
Teneur élevée :
tonnes de teneur élevée = p10 × Vol × SG
métal de teneur élevée = p10 × g10 × Vol × SG
métal de teneur élevée/tonnes de teneur élevée (= g10)
Le tonnage de stériles sera de :
Stériles :
tonnes de stériles = p0 × Vol × SG - p5 × Vol × SG
Si la teneur de coupure utilisée ne coïncide pas avec une valeur d'indicateur spécifique, il sera nécessaire d'insérer une nouvelle valeur « indicateur » au point approprié et d'interpoler un ensemble de valeurs appropriées pour la proportion et la teneur (et le métal).
Si un seuil de valeur est utilisé (par exemple, une valeur nette de fonderie), il peut être nécessaire de calculer les tonnes, les teneurs et le métal pour chaque classe d'indicateurs, de calculer le revenu de chaque classe, de calculer les coûts de chaque classe et de déterminer si leur rendement est positif ou négatif pour chaque classe. Ensuite, marquez chaque classe d'indicateurs comme minerai ou stérile et résumez les tonnes de minerai et de métal de chaque bloc dans un ensemble de champs de minerai.
4.5. KRIGEAGE À INDICATEURS LOCALISÉS/CONDITIONNEMENT UNIFORME
Le krigeage à indicateurs localisés (LIK) et le conditionnement uniforme (UC) sont des types de modèles peu communs qui sont utilisés pour surmonter certains des problèmes inhérents à l'utilisation des modèles MIK. Il s'agit de variantes du même objectif, à savoir remapper les histogrammes MIK en blocs de taille SMU au sein d'un bloc de panneaux plus grand.
LIK/UC éliminent les zones de faible ou haute teneur non exploitables lorsqu'il s'agit de petits tonnages pour les indicateurs ayant de petites proportions (inférieures à la taille réelle de la SMU).
Le processus LIK consiste à créer un modèle OK à l'aide d'une taille de bloc égale ou proche de la taille d'une SMU. Ce modèle sera probablement lissé à l'excès ou biaisé de manière conditionnelle.
Le modèle OK n'est utilisé que pour localiser la distribution MIK qui sera ensuite utilisée pour remplacer localement les teneurs estimées OK.
L'histogramme MIK (la proportion du bloc dans chaque classe d'indicateurs) pour chaque panneau est ensuite divisé en classes de tonnages régulièrement espacées, où le nombre de classes est égal au nombre de blocs SMU dans le panneau. La valeur de la teneur de chaque bloc est ensuite calculée par interpolation de l'histogramme MIK.
Une fois les panneaux définis, les blocs du modèle OK sont classés dans une liste par teneur par ordre croissant, de la plus basse à la plus haut edans chacun des panneaux (l'emplacement des blocs n'est pas déplacé). Les gradations provenant des histogrammes remappés sont ensuite placées dans les blocs dans le même ordre, en remplaçant la valeur OK et en transformant la distribution en celle du modèle MIK.
Les blocs SMU du panneau ont la même base d'estimation sélective que l'histogramme MIK parent, mais sont désormais présentés sous forme de blocs OK de taille SMU qui peuvent être plus facilement traités dans le processus de planification minière.
4.6. MODÈLES DE SIMULATION CONDITIONNELLE (ConSim)
La simulation conditionnelle (ConSim) est en fait une extension spatiale de la simulation de Monte Carlo. Une série de « réalisations » potentielles de modèles est générée, représentant une gamme de modèles possibles plausibles qui sont compatibles avec les statistiques connues du variogramme des teneurs et des histogrammes des teneurs.
L'utilisation pratique de ces modèles dans la planification minière est encore du ressort des universitaires et des chercheurs. Par conséquent, si l'un de ces modèles est présenté, il est recommandé de tenir une « longue » discussion avec le client/« demandeur » pour comprendre ce qu'il souhaiterait concernant le modèle.
Le but du modèle ConSim est de caractériser et de reproduire la variance des données d'entrée.
Une simulation est dite « conditionnelle » si les réalisations générées sont fidèles aux points échantillonnés. Plus précisément, un modèle de blocs de simulation conditionnelle est utilisé pour simuler les caractéristiques spatiales et statistiques d'un gisement, ce qui permet de :
- Reproduire la variabilité des données d'entrée.
- Reproduire la continuité des données d'entrée.
- Mesurer la probabilité du résultat souhaité (risque).
- Reconnaître qu'il existe de nombreux modèles de réalité tout aussi probables.
En simulation conditionnelle :
- La teneur est simulée sur une grille dense de points.
- Les simulations sont calculées en blocs de SMU.
- Les estimations de tonnage et de teneur sont obtenues en appliquant un seuil de coupure aux SMU.
Le résultat est une série de réalisations équiprobables, comme le montre la figure 18.
Bien que les géologues travaillant dans ce domaine soient convaincus que la méthode améliorera la compréhension de l'incertitude géologique potentielle, qu'une estimation géologique unique ne peut pas fournir, certains inconvénients majeurs empêchent probablement l'utilisation des modèles ConSim dans la pratique à l'heure actuelle :
- La méthode prend plus de temps que les autres méthodes.
- Il n'existe pas de moyen facilement accepté d'utiliser les résultats de ConSim dans la planification minière. Cela nécessite actuellement plusieurs conceptions et calendriers, comme le montre la figure 19.
- Très peu de travaux, voire aucun, ont été réalisés pour quantifier dans quelle mesure une collection donnée de réalisations représente la gamme totale d'incertitude dans les conceptions minières. En effet, Dimitrakopoulos et al. (2007) déclarent que « bien que les modèles de gisements simulés soient tout aussi probables, les conceptions correspondantes ne le sont pas » (p.76).
- Heidari (2015), à l'aide d'un gisement connu et bien foré, a montré que le modèle réel (un ensemble de données exhaustif) était plus proche de la limite des espaces d'incertitude des modèles simulés (en utilisant un sous-ensemble de données plus éparse) que des centres (la « moyenne » des réalisations était donc en fait un mauvais indicateur de la « vérité » ).
Figure 18 : exemple de plusieurs résultats de modèles avec ConSim
Figure 19 : méthode basée sur les risques pour la planification minière à l'aide de ConSim
4.7. MODÈLES DE COUCHES EN GRILLE
Les modèles de couches en grille (GSM) sont utilisés pour les gisements stratiformes. Techniquement, il ne s'agit pas de « modèles de blocs ».
Ils ont des dimensions de blocs constantes dans les directions X et Y (ils peuvent être rectangulaires), mais ils ne comptent qu'un bloc par couche dans la direction Z et son épaisseur varie avec l'épaisseur de la couche.
Ils se composent d'un ensemble de matrices bidimensionnelles, chaque grille représentant une surface ou une valeur, comme le montre graphiquement la figure 20. Les fichiers de grille sont contenus dans une structure de type de tableau ou sous forme de fichiers individuels avec une convention de dénomination prescrite, ce qui permet au logiciel de maintenir une « compréhension » de chaque partie de la surface dans son ensemble.
Les surfaces sont les résultats de l'interpolation d'un ensemble de données irrégulièrement espacées dans une matrice régulière et fixe appelée « grille ». La méthode d'interpolation sur la grille peut différer en fonction du logiciel.
Les besoins en espace sur le disque sont généralement faibles, car chaque point de grille est défini par sa position par rapport à un point de référence. (En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de stocker toutes les coordonnées Est et Nord).
Figure 20 : structure d'un modèle de couches en grille
4.8. MODÈLES HARP
Un modèle HARP (Horizon Adaptive Rectangular Prism) est un modèle de blocs stratigraphiques hybrides qui tente de correspondre plus étroitement à la forme des limites interprétées qu'un modèle de blocs.
Un modèle HARP est spécifiquement conçu pour permettre aux unités stratigraphiques d'être représentées sans pratiquement aucune perte d'intégrité structurelle en permettant aux sommets et aux bases des blocs HARP individuels de se « plier » en fonction des surfaces d'entrée. Ils sont ainsi en mesure de suivre et de représenter des caractéristiques telles que des failles normales, inverses et chevauchantes complexes.
Les modèles HARP sont un produit de Maptek-Vulcan, développé et décrit dans Odins (2011).
Un modèle HARP présente deux caractéristiques principales lui permettant de suivre la stratigraphie de près :
- Une hauteur de bloc à variation infinie, de sorte que l'étendue verticale du bloc soit exactement celle de l'épaisseur de l'horizon à un emplacement donné du plan.
- Les quatre points d'angle de la base et du sommet d'un bloc, ainsi qu'un cinquième point central, ont des élévations entièrement indépendantes.
Ainsi, chaque modèle HARP se compose de dix points (cinq supérieurs et cinq inférieurs) qui lui permettent de suivre de près les horizons stratigraphiques, comme le montre la figure 21.
Chaque bloc HARP du modèle « connaît » son propre nom d'horizon, son emplacement, son étendue, son volume et potentiellement des milliers de paramètres associés.
Les blocs ne sont pas obligés de s'étendre en continu d'un horizon à l'autre. Le sous-blocage peut être utilisé pour créer un bloc d'une épaisseur fixe par rapport aux surfaces supérieure ou inférieure.
Les modèles HARP conservent pratiquement tous les attributs d'un modèle de blocs standard. Les utilisateurs ont à leur disposition un large éventail d'options d'estimation des teneurs, y compris, mais sans s'y limiter, la variographie et le redressement, le krigeage, le cokrigeage et la simulation.
À ce stade, Deswik ne prend pas en charge les modèles HARP. Il sera nécessaire d'importer les surfaces qui ont été utilisées pour générer le modèle Vulcan HARP, puis de créer et d'interroger un modèle Datamine par rapport au modèle Vulcan HARP à l'aide de ces surfaces.
Figure 21 : vue schématique d'un bloc HARP unique, montrant les niveaux relatifs des coins
Figure 22 : représentation du modèle HARP d'une faille inverse
5. Problèmes à connaître
5.1. APERÇU
Il est probablement vrai que tous les modèles de blocs que vous recevez et utilisez seront « erronés » d'une manière ou d'une autre, mais il est probable que la plupart seront suffisamment précis pour être utiles s'ils sont utilisés correctement.
Étant donné que la plupart des modèles seront faux dans une certaine mesure, il est utile de comprendre où et comment le modèle peut être incorrect afin qu'il puisse être jugé adéquat ou non.
Un modèle de blocs de ressources ne sera aussi bon que les fondations géologiques sur lesquelles il est construit.
L'intention n'est pas de transformer l'ingénieur lisant ce document en un géologue, mais l'auteur encourage les ingénieurs à lire et à réfléchir aux intrants géologiques des modèles utilisés et aux techniques de modélisation utilisées pour créer les modèles. Cela améliorera votre travail.
Dans les sections suivantes, l'auteur abordera certains éléments pour aider l'ingénieur à comprendre les limitations des données qu'il a reçues.
5.2. CERTAINES SOURCES D'ERREUR
Dominy, Noppe et Annels (2002) énumèrent cinq raisons géologiques principales pour lesquelles les estimations des ressources sont incorrectes :
- Données de mauvaise qualité concernant les échantillons et les analyses
- Un manque de connaissances géologiques détaillées de la mine et de compréhension fondamentale du gisement
- Mauvaise interprétation des caractéristiques de distribution des teneurs
- Mauvaises compréhension et application des techniques d'estimation assistée par ordinateur
- La non-reconnaissance de l'effet de la sélectivité et de l'effet du changement de support ou de la variance du volume, à savoir que l'exploitation minière doit être pilotée en fonction des teneurs de blocs de grand tonnage et non des échantillons de petit volume.
En outre, il y a le simple problème du manque de données suffisantes.
Dominy, Noppe et Annels (2002) énumèrent également un bon ensemble de raisons constatées dans la pratique pour réviser à la baisse les estimations des ressources/réserves à la suite d'études/audits de faisabilité et de diligence raisonnable opérationnelle. Il a été constaté que cela concerne généralement :
- L'orientation des trous de forage par rapport à la zone de minerai/orientation de minéralisation dominante
- Volumes d'échantillon primaire, de sous-échantillon ou de pulpe inadéquats
- Qualité, précision et reproductibilité (précision et biais) des analyses
- Mauvaise corrélation entre les analyses de doublons issus de divisions d'échantillons de terrain
- Récupération des échantillons de minerai médiocre ou variable
- Récupération d'échantillons hautement variable
- Techniques d'échantillonnage biaisées
- Présence d'or grossier
- Techniques de forage inappropriées et/ou mixtes (par exemple, forage à circulation inverse (RC) humide)
- Mauvaise corrélation entre les analyses de trous jumelés (par exemple, RC vs RC ou RC vs DDH)
- Contamination/étalement dans le trou de forage
- Manque de relevés d'orientation des trous de forage quand ils sont longs
- Combinaison de données d'échantillons qui sont incompatibles sur le plan statistique ou du point de vue de la quantité et de la qualité des échantillons
- Problèmes avec le compositage des données d'échantillons brutes
- Continuité géologique et/ou des teneurs mal comprise ou démontrée
- Interprétation géologique et techniques de modélisation géologique inappropriées
- Techniques d'estimation des ressources inappropriées
- Détermination inadéquate de la densité apparente du minerai et des stériles
- Mauvaise dilution et mauvaise évaluation des pertes
- Hypothèses peu pratiques de planification minière (continuité des blocs et formes pratiques d'exploitation minière)
- Problèmes de récupération métallurgique
Les consultants AMC ont une liste de problèmes similaire découverts au cours de leurs audits, notamment :
- Des données de forage groupées produisant une faible densité de données en marge de la minéralisation
- Interprétations et hypothèses géologiques incorrectes
- Domaines géologiques non liés à la continuité des teneurs
- Trop peu ou trop de domaines géologiques
- Données insuffisantes pour caractériser la distribution des teneurs dans le domaine
- Regroupement des données — dégroupement nécessaire pour définir les statistiques de teneur
- Populations de données mixtes entraînant des résultats ambigus
- Mélange de types d'échantillons, par exemple ancien/nouveau, circulation inverse/carotte, souterrain/surface
- Erreurs d'échantillonnage ou d'analyse
- Teneurs anormales ou inhabituelles
- Stratégies de limitation des valeurs de teneur extrêmes
- Manque de compétences analytiques pour caractériser les statistiques des teneurs
- Interprétation incorrecte des résultats
- Domaines d'estimation définis par un modèle filaire mal construits
- Données inadéquates, densité de données variable, extrapolation excessive
- Travail à une échelle inappropriée
- Sélection de la méthode d'estimation de la qualité médiocre
- Traitement inapproprié des valeurs aberrantes
- Contrôles inappropriés des modèles/lissage excessif
- Taille de blocs inappropriée pour la densité des données
- Biais dans les estimations, résultant du lissage
- Incorporation inappropriée de la dilution de bordure/perte de minéraux
- Sélection des teneurs de coupure inappropriée
- Estimations qui ne sont pas conciliées avec la géologie et les données brutes
(source : AMC, présentation des enseignements tirés)
La liste ci-dessus a pour but d'illustrer qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un modèle de blocs est erroné et que les ingénieurs miniers peuvent faire peu de choses pour les identifier (à l'exception du rapprochement avec les résultats réels du forage de contrôle de teneur et des performances de l'installation). Sachez toutefois que cette circonstance n'est pas rare.
Il est à noter qu'une erreur de 10 % dans l'estimation de la teneur n'est pas rare (par exemple, sur une période d'un an) et est généralement considérée comme acceptable. Pour une exploitation souterraine, on considère que, même pour une bonne exploitation, les coûts de production sont à un niveau d'au moins 50 % à 75 % des revenus du site minier. On peut voir que même une diminution de 10 % de la qualité peut se traduire par une diminution de 20 % à 40 % de l'excédent d'exploitation. Cela suffit pour rendre un projet financièrement fragilisé.
5.3. DONNÉES INSUFFISANTES
Dans la modélisation géologique, il y aura toujours une question de savoir si les données sont suffisantes. La clé est de pouvoir collecter suffisamment de données (espacement des forages) pour entreprendre une planification à long terme raisonnablement précise et pour définir une meilleure précision pendant l'exploitation minière à l'aide du forage de contrôle de teneur.
Au stade de l'étude de faisabilité, les coûts empêchent généralement une densité de forage de définir un corps entier de minerai avec une bonne précision.
Un exemple d'effet du « plus de données géologiques » est montré à la figure 23 d'une étude entreprise par Dowd et Scott (1984) pour un groupe complexe de trois corps de minerai d'argent/plomb/zinc dans la mine Hilton, dans le nord-ouest du Queensland, en Australie. L'interprétation des limites du corps de minerai à un espacement de 20 m de forage est beaucoup plus fluide (moins variable, plus continue) que l'interprétation estimée à partir d'un espacement de 5 m.
Figure 23 : interprétation de la coupe transversale basée sur un espacement de forage de 20 m, puis de 5 m
La figure 24 montre les superpositions de l'interpolation à espacement de 5 m sur l'interpolation à espacement de 20 m et vice versa. On peut voir la quantité de dilution et de pertes qui seraient encourues en utilisant l'espacement de 20 m par rapport aux interprétations de 5 m.
Figure 24 : superposition d'une interpolation de 20 m et d'une interpolation de 5 m.
a) Si le modèle à 20 m est utilisé, le bleu clair visible représente la dilution ;
b) Si le modèle de 20 m est utilisé, les zones bleu foncé visibles représentent la perte de minerai
Il convient également de noter que, même pour les mêmes données, différents géologues peuvent donner des interprétations différentes, en fonction de leur expérience et de leurs biais. Un exemple de cela est donné à la figure 25, où trois géologues, ayant reçu les mêmes données de trous de forage, ont interprété les lentilles de minerai de manière assez différente.
Figure 25 : coupe transversale des interprétations géologiques de trois géologues avec les mêmes données
5.4. MANQUE DE COMPRÉHENSION FONDAMENTALE DES CONTRÔLES GÉOLOGIQUES
Les modèles géologiques ne sont bons que si la qualité et l'interprétation des données sont adéquates, ainsi que si l'échelle à laquelle les données sont collectées est appropriée.
Les teneurs sont interpolées ou extrapolées en blocs et l'interpolation/extrapolation sont généralement contraintes par les maillages filaires des limites du gisement définies par l'enregistrement des trous de forage, l'échantillonnage et la cartographie du gisement.
La mine Stekenjokk en Suède a fourni l'un des exemples les plus frappants des risques liés à l'interpolation de la continuité du minerai à partir de données de forage de surface sans une compréhension plus approfondie de la macro et micro structure présente.
Deux horizons minéralisés à pendage faible ont été supposés, mais le minerai se trouvait en réalité dans un complexe étroitement plissé, comme le montre schématiquement la figure 26.
Figure 26 : interprétation par rapport à la structure réelle du minerai à la mine Stekenjokk
Un autre exemple où des « points sont reliés » plutôt que d'utiliser toutes les informations géologiques disponibles est présenté ci-dessous à la figure 27 (schéma des données réelles de la mine Lady Lorretta).
Figure 27 : coupe transversale schématique montrant l'interprétation des lentilles minéralisées
Il sera difficile pour les ingénieurs utilisant des modèles géologiques de reconnaître de telles erreurs, mais une erreur qui peut être vérifiée est le problème du modèle de blocs à distribution en « pelage de chien tacheté ».
Le « pelage de chien tacheté » (spotted dog en anglais) est un terme inventé par Stephenson et al (2006) pour décrire un modèle résultant d'une classification de la confiance des ressources attribuée uniquement à la présence de trous de forage sans tenir compte de la continuité géologique dans le gisement, comme le montre la figure 28.
Figure 28 : le modèle géologique du « pelage de chien tacheté »
Il est à noter que ces modèles de « pelage de chien tacheté » sont susceptibles d'être incompatibles, sinon de violer, les exigences des normes de rapports telles que le code JORC, le code SAMREC, le code Reporting Code NI 43-101/CIM et même l'Industry Guide 7 de la SEC. Toutes ces normes traitent de la continuité de la géologie et de la teneur en termes de trous de forage (au pluriel), ce qui implique une corrélation ENTRE les trous de forage, et non pas autour de trous de forage individuels.
Il semble que ces types de modèles aient augmenté en raison de l'utilisation accrue des géostatistiques pour l'estimation des teneurs, ce qui permet de générer et d'utiliser les paramètres et les attributs bloc par bloc, et les géologues consacrent plus de temps aux détails d'un modèle de blocs et moins de temps (souvent pas de temps du tout) à examiner et à interpréter les sections transversales et les plans papier.
En ce qui concerne les sections transversales, il convient de noter que la pratique commune de la plupart des géologues est d'interpréter un gisement par section verticale. Jun Cowan note qu'il s'agit probablement d'une mauvaise pratique pour l'interprétation des corps de minerai (https://www.linkedin.com/pulse/why-i-give-geological-cross-sections-cold-shoulder-jun-cowan/), car la plupart des gisements de minéraux ont rarement une caractéristique structurelle de contrôle horizontal.
Les géologues tracent et interprètent régulièrement les sections transversales verticalement. (C'est ce qu'on leur a appris à faire). Toutefois, les modèles géologiques à transmettre ne peuvent pas être compris si la coupe transversale n'est pas un plan de symétrie du modèle de minéralisation en 3D.
Cowan souligne que nous avons oublié les techniques très élémentaires et efficaces consistant à identifier les modèles de symétrie qui existent dans les roches déformées qui contrôlent la minéralisation. L'analyse de symétrie - une compétence essentielle considérée comme une condition préalable de l'analyse cinématique et développée il y a près de 90 ans - n'est plus pratiquée par les géologues modernes.
L'industrie minière dans son ensemble ignore régulièrement la symétrie des gisements minéraux, malgré le fait que la plupart des tendances minéralisées imitent la symétrie structurelle sous-jacente des roches hôtes. Les géologues des ressources examinent rarement les modèles de minéralisation pour les informer de la symétrie structurelle. Il n'est donc pas rare que la symétrie des gisements minéraux, et donc les contrôles de la minéralisation, passent inaperçus pendant de nombreuses années.
Un exemple typique d'un gisement minéral avec ses orientations de section transversale par défaut (violet) (c'est-à-dire parallèlement à la clôture du trou de forage) et le plan de symétrie (vert) est montré à la figure 29. L'axe structural linéaire, qui coïncide avec l'axe long de minéralisation, est parallèle à la flèche rouge.
Un tel gisement ne convient pas à l'interprétation géologique à l'aide de sections transversales traditionnelles parallèles aux clôtures de trous de forage. Ce non-parallélisme entre les plans de section transversale et la section de symétrie est typique de la plupart des gisements de minéraux.
Figure 29 : exemple typique de section transversale par défaut par rapport à la position du plan de symétrie
Les figures 30 et 31 montrent comment l'utilisation de sections non standard (plongement normal par rapport au corps de minerai) peut être utilisée pour découvrir des aspects des structures de contrôle de minéralisation.
Figure 30 : exemple de l'interprétation de la structure avec des échantillons de teneur tracés sur la projection du plan de symétrie
Figure 31 : un ensemble de données synthétiques avec « minerai » en rouge et « stériles » en bleu pour illustrer la puissance de la sélection correcte du plan de symétrie
a) Les teneurs faibles entourent les teneurs élevées, de sorte que la géométrie du minerai ne peut pas être facilement déchiffrée. b) La projection de l'intensité maximale sur une direction de vue arbitraire ne produit rien qui soit géologiquement sensible. c) Seule l'orientation descendante révèle un profil de plissage. (Cowan, 2014)
5.5. SÉLECTIVITÉ - SMU - DILUTION - PERTE
En général, les blocs d'estimation qui sont considérablement plus petits que le maillage moyen du forage (par exemple, nettement moins de la moitié de la taille) sont potentiellement très risqués. Dans les situations d'effet pépite à très haut niveau (or épithermal et or logé dans des zones de cisaillement, par exemple), même les blocs avec des dimensions se rapprochant de l'espacement de forage peuvent encore présenter des risques élevés.
La pratique banale consistant à estimer des blocs beaucoup trop petits est symptomatique d'une incompréhension des géostatistiques de base.
Le concept de SMU est discuté plus avant dans une section suivante, car il s'agit d'un domaine sur lequel un ingénieur peut avoir une influence après qu'un modèle géologique a déjà été livré.
En association avec les SMU, les problèmes parallèles de dilution et de perte apparaissent. Encore une fois, ce point est examiné plus avant dans une section suivante, car il incombe en grande partie à l'ingénieur de s'assurer que la dilution et la perte ont été correctement prises en compte.
6. Le concept de SMU
6.1. APERÇU
La définition conventionnelle de la SMU est le plus petit volume de matériau sur lequel la classification des minerais/stériles est déterminée.
La SMU est un concept issu d'une estimation géostatistique et se rapporte à la plus petite unité pouvant être exploitée de manière sélective. Cela varie en fonction du style de minéralisation, de la méthode d'exploitation minière et de la taille de l'équipement. En règle générale, elle peut être assez réduite dans les opérations sélectives (en d'autres termes, quelques chargements de camions - quelques centaines de tonnes dans une mine d'or à ciel ouvert typique), mais dans la pratique, l'interpolation d'un grand nombre de petits blocs aura pour effet que la plupart des blocs voisins auront les mêmes teneurs ou des teneurs très similaires. Ainsi, dans la pratique, de nombreux travailleurs géostatistiques éviteront d'estimer un bloc plus petit qu'un quart à un cinquième de l'espacement de forage, ce qui est parfait pour les modèles de ressources globales. Cela dépasse normalement les volumes de blocs partiels liés aux limites géologiques.
Toutefois, lors de l'optimisation des fosses ou de la planification de la durée de vie des mines, il est souhaitable de représenter les degrés réels de sélectivité possibles dans la pratique. C'est là que les estimations de la proportion probable du bloc minéralisé qui pourrait être extrait de manière sélective deviennent importantes. La clé de ces estimations est la prévision des tonnages de matériau de la SMU ou d'unités de plus grande taille qui pourraient être exploitées de manière sélective. Il peut s'agir uniquement d'une partie du bloc qui a été estimé, ou d'une agrégation de blocs qui ont été estimés.
Les géologues des ressources utiliseront des techniques impliquant l'interrogation de la courbe de tonnage d'un gisement et l'erreur d'estimation pour calculer ces proportions.
Le concept de la SMU est donc de sélectionner la taille la plus petite des cellules régulières pouvant être exploitée par des équipements miniers de taille appropriée. La taille de l'équipement est sélectionnée pour correspondre à l'échelle de l'exploitation. Cette approche est basée sur le principe que les grands équipements ne peuvent généralement pas exploiter des SMU de petite taille. En outre, on part généralement du principe que la taille du parc d'équipements miniers doit être minimisée, en choisissant le plus grand équipement possible.
En règle générale, le choix de la SMU inclut :
- Taille du bloc parent du modèle de ressources
- La largeur ou la profondeur moyenne du gisement
- Hauteur de la banquette de production ou hauteur de la sous-banquette
- Hauteur finale du parement
- Effet sur la viabilité économiquee du projet de la dilution et des contaminants
- Capacité de production et donc notion préconçue de la taille des équipements d'excavation et de transport
En réalité, la sélection des PMU semble être un domaine complexe et « flou ». À la suite de lectures approfondies, il n'existe pas de méthode de sélection de la SMU agréée à l'échelle de l'industrie et il s'agit souvent d'une opération de « succion du pouce » par le géologue des ressources. Cela est particulièrement vrai pour un nouveau modèle de ressources de projet, où les travaux n'ont même pas été effectués pour décider à quoi ressemblera la mine et quelle sera la taille des équipements.
Il convient également de noter qu'il est peu pratique et impossible de sélectionner librement une seule SMU de minerai au milieu de stériles, tout comme il est impossible de rejeter librement une seule SMU de minerai au milieu de stériles. (Il y aura donc des effets de perte et de dilution au-delà de la simple sélection de la taille de la SMU.) Néanmoins, même les grands équipements d'exploitation minière en vrac peuvent avoir la capacité d'exploiter la mine à quelques mètres d'une limite si les conditions sont favorables.
Leuangthong et al (2004) discutent d'une méthode de sélection de la SMU basée sur une définition de la SMU en tant que « la taille du modèle de blocs qui permettrait de prédire correctement les tonnes de minerai, les tonnes de stériles et la teneur d'alimentation diluée que l'usine recevra avec la pratique de contrôle des teneurs prévues ». Il s'agit d'une situation hautement sensible, car il s'agit de la situation idéale recherchée par un ingénieur de planification et d'ordonnancement minier : une taille de SMU qui correspond raisonnablement à la production réelle (si possible).
Leuangthong et al (2004) estiment que cette taille doit non seulement être liée à la capacité de l'équipement à sélectionner les matériaux, mais doit également être basée sur les données disponibles pour la classification (trous de dynamitage ou forage dédié au contrôle des teneurs), les procédures utilisées pour traduire ces données en limites de creusement exploitables et l'efficacité avec laquelle l'équipement minier parvient à creuser ces limites.
Il faut également tenir compte de nombreuses sources de dilution, y compris la dilution interne due à la variabilité des teneurs au sein de la SMU, la dilution externe résultant de contacts géologiques/géométriques et la dilution opérationnelle qui tient compte des erreurs de production, des pressions et des impératifs de calendrier.
Bien que le concept consistant à utiliser la SMU pour obtenir une correspondance entre la ressource et la production réelle soit un objectif extrêmement utile, cette approche soulève d'autres problèmes : des effets tels que les blocs de taille minimale pratique (plus grands que la SMU), les effets des imperfections minières (tels que le mouvement de dynamitage) et l'« effet des données » (manque de données d'échantillons géologiques suffisantes). Tous ces facteurs entraînent des problèmes de rapprochement, le plus courant étant que le modèle de ressources finit par surprévoir le métal dans le modèle de ressources par rapport au modèle de contrôle des teneurs de métal plus étroitement foré (et donc fournissant une plus grande quantité de données). L'auteur a noté que pour la dizaine de mines pour lesquelles il a vu des informations de rapprochement détaillées, environ 70 % étaient dotés de modèles de ressources qui surprévoyaient le métal contenu de plus de 10 % (et avec jusqu'à 35 % de différence).
Les spécialistes des ressources/réserves travaillant dans des environnements miniers en exploitation notent généralement que les mines ont tendance à extraire plus de tonnes à faible teneur que ne le dit le modèle de ressources (probablement plus de 90 % du temps). Le fait que cela entraîne une surestimation ou une sous-estimation du métal contenu dépendra de la forme de la courbe de tonnage et de la teneur de coupure utilisée. Toutefois, dans tous ces cas, le tonnage plus élevé entraînera des coûts plus élevés que prévu par unité de métal. L'auteur a toujours soupçonné que la sélection des SMU était une grande partie de ce problème (pas le seul, bien sûr).
À la recherche de conseils sur la sélection des SMU, il a été noté que dans une étude de Buzwagi (Rocca et al, 2007), les conditions suivantes ont été utilisées :
- La largeur du godet est inférieure à 75 % de la dimension la plus étroite du bloc SMU.
- Un minimum de deux camions chargés par bloc est nécessaire, soit environ 10 godets d'excavation par SMU.
Ces conditions pourraient donc constituer un point de départ raisonnable pour évaluer une SMU à utiliser.
Pour appliquer une SMU à un modèle OK, le modèle devra être régularisé à la taille de SMU. Dans Deswik, cela signifie créer un nouveau cadre de modèle (et des blocs vierges) à la nouvelle taille de modèle de blocs et utiliser la commande de régularisation pour remplir ce nouveau modèle de blocs avec les données du modèle de blocs non régularisés (il faut réfléchir à la façon dont les différents matériaux sont « introduits » dans une SMU car, par définition, une SMU ne peut être constituée qu'd'un seul type de matériau).
Pour appliquer une SMU à un modèle MIK, plusieurs approches sont utilisées. Si, en tant qu'utilisateur du modèle, vous êtes satisfait de la taille de la SMU sélectionnée par le géologue lorsque la correction du changement de support a été appliquée, il est uniquement nécessaire de s'assurer que les proportions de minerai et de stériles dans chaque bloc sont supérieures à la taille de la SMU utilisée. Si la taille fondamentale de la SMU utilisée par le géologue des ressources dans la construction du modèle MIK est trop petite, il est préférable de consulter le géologue des ressources et de demander un nouveau modèle à la taille convenue de la SMU. (Les corrections de changement de support nécessitent des logiciels et des connaissances spécialisés).
6.2. EFFET DE LA SMU SUR L'OPTIMISATION DE LA FOSSE
Afin de comprendre l'effet de l'utilisation d'une SMU appropriée par rapport à la non-utilisation d'une SMU, l'auteur a entrepris une analyse d'une optimisation de la fosse de modèle SMU régularisé par rapport au modèle de blocs irréguliers d'origine (à l'aide du modèle de blocs d'apprentissage standard de Deswik). Cette courte étude a mis en évidence l'ampleur de l'erreur de volume potentielle dans l'enveloppe RF=1 résultante avec un modèle de blocs trop sélectif.
Le modèle de blocs irréguliers à sous-cellules à la limite du champ de minerai contient des blocs jusqu'à une taille de 0,06 m3. La distribution de la taille des blocs (y compris tous les blocs à sous-cellules) est indiquée par fréquence et par volume à la figure 32.
Figure 32 : distribution de la taille des blocs de minerai par nombre, fréquence et volume dans le modèle à sous-cellules non régularisé
La taille de la SMU sélectionnée pour l'analyse était de 250 m3. Le processus de régularisation est tel que chaque bloc (100 % ) du modèle de blocs a désormais une taille de 250 m3.
Les deux enveloppes potentielles RF=1 sont représentées à la figure 33 par rapport au modèle de blocs sur-sélectifs irréguliers à gauche et au modèle de blocs régularisés de SMU à droite.
Pour le modèle de blocs sursélectifs irréguliers, la enveloppe RF=1 résultante (enveloppe de section rouge à la figure 33) était 15 % plus grande (en volume) que le modèle de blocs régularisés de SMU RF=1 (enveloppe de section bleue à la figure 33) et, plus important encore, avec une valeur calculée de 122 % supérieure par tonnes totales déplacées dans l'enveloppe (une valeur qui ne sera pas atteinte dans la pratique).
Figure 33 : coupe transversale des enveloppes de pseudoflow RF=1 pour le modèle de blocs bruts irréguliers par rapport au modèle de blocs régularisés de SMU
Notez que pour cette étude :
a) Le rendement métallurgique de l'usine dépendait de la teneur et la valeur par bloc variait donc d'un pourcentage supérieur à celui de la simple variation de teneur.
b) La teneur moyenne des minerais n'a changé que d'environ 2 % avec la régularisation par SMU (1,59 g/t contre 1,63 g/t), mais le résultat de l'optimisation a changé beaucoup plus, ce qui indique la sensibilité du projet à la dilution.
(c) Le volume de minerai ayant atteint une teneur spécifique a changé avec la régularisation de la SMU, comme le montre la figure 34. (Le modèle SMU présentait un volume plus élevé en dessous de chaque teneur de coupure et donc un volume plus bas au-dessus de chaque teneur de coupure par rapport au modèle de blocs à sous-cellules bruts). L'effet de la régularisation de la SMU changera donc en fonction de la teneur de coupure nécessaire.
Figure 34 : variation du volume en dessous d'une teneur de coupure spécifique pour le modèle régularisé de SMU par rapport au modèle de blocs bruts.
6.3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L'UTILISATION DE SMU POUR L'ÉVALUATION DES PERTES ET DE LA DILUTION
Le rapprochement de la ressource tout au long de la chaîne des processus miniers jusqu'aux résultats du traitement (et des ventes) déterminera si l'utilisation d'une SMU est appropriée pour l'estimation des effets de la dilution et des pertes pour l'exploitation minière.
Il existe des situations où l'utilisation d'une SMU régulière peut ne pas être appropriée.
L'utilisation d'une SMU présente les avantages suivants :
- Elle offre des temps de calcul relativement rapides, ce qui permet de tester une variété de tailles de SMU.
- Elle peut être utilisée en combinaison avec d'autres taux de récupération minière et marges de dilution.
- Elle comprend les teneurs de la minéralisation diluante à partir de cellules limites. Cela est particulièrement important avec les gisements ayant des limites de teneurs graduées.
- Elle comprend la modélisation de la perte de minerai aux limites du gisement.
- Elle permet l'évaluation économique des classes de cellules diluées grâce à un logiciel d'optimisation. Il s'agit d'une considération importante pour les blocs de minerai à teneur marginale à grande profondeur.
(Bannister, 2016)
Les inconvénients de l'utilisation d'une SMU sont les suivants :
- Les équipements miniers peuvent exploiter des formes autres que des cuboïdes rectangulaires.
- Les estimations de la dilution et de la récupération minières sont basées sur l'exploitation précise du cuboïde SMU et non sur la géométrie du gisement interprétée.
- Les gisements avec des limites géologiques physiques et visuelles fortes ne sont pas reconnus dans l'estimation de la dilution.
- Les systèmes de contrôle des teneurs proposés, tels qu'un forage ultérieur, la cartographie et la localisation de minerais, ne sont pas autorisés.
- Les précisions du modèle géologique et du marquage de levé ne sont pas prises en compte.
- Le déplacement du minerai résultant du soulèvement et de la projection lors du dynamitage ne sont pas pris en compte.
- Les pertes de minerai dues aux effets de bordure sur le minerai abattu ne sont pas prises en compte (pied de bloc de minerai non excavé à côté des blocs de stériles).
- Dilution du minerai due aux effets de bordure dans le minerai abattu (la crête du bloc de stériles tombe dans le bloc de minerai pendant l'excavation).
- La mauvaise direction de la répartition du minerai n'est pas incluse.
- L'orientation de la SMU par rapport aux limites du gisement et aux centroïdes des cellules a une influence significative sur la récupération et la dilution minières.
- Les modifications d'orientation des cellules de la SMU prennent du temps et ne sont généralement pas entreprises.
(Bannister, 2016)
7. Dilution et perte
7.1. APERÇU
Lors de la conversion des informations contenues dans un « modèle de blocs » de ressources minérales en un ensemble de tonnages et de teneurs récupérables par exploitation minière (les réserves de minerais), il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs de modification, y compris la dilution et la perte.
Une forme de dilution ou de perte se produira invariablement dans le processus d'exploitation minière physique. À moins qu'un rapprochement des ressources ne suggère autrement (par exemple, un résultat de rapprochement positif donnant plus de tonnes, de teneur ou de métal que celui modélisé), il sera invariablement dû à une sous-estimation du modèle de ressources sous-jacent, qui masque les effets de la dilution et des pertes.
Les approches qui ont été utilisées pour l'estimation de la dilution et de la perte sont les suivantes :
- Estimations des facteurs en pourcentage (basées sur les facteurs d'appel miniers historiques ou des estimations approximatives utilisées dans l'industrie)
- Expansions de la surface / couches de dilution
- L'utilisation d'une SMU - régularisée sur la grille de modèle de blocs ou irrégulière le long d'une limite de contact
Quelle que soit la méthode utilisée, il est recommandé de procéder à un rapprochement avec les tonnes alimentant l'usine de traitement, la teneur et le produit minéral réel produit, afin d'affiner la méthode pour donner des résultats acceptables.
Les facteurs de modification à prendre en compte sont les suivants :
a. Facteurs de rapprochement du modèle de réserves/modèle de contrôle des teneurs
Cela s'explique par les différences entre le modèle de contrôle des teneurs à court terme (forage rapproché) et le modèle de ressources minérales à long terme (forage de ressources moins denses). Les facteurs sont généralement déterminés par rapprochement entre les deux types de modèles.
La dilution et les pertes modélisées par ce processus sont dues à la connaissance incertaine du corps de minerai, qui s'améliore à mesure que la densité de forage augmente.
b. Dilution interne
Il s'agit de l'inclusion de stériles avec un bloc de minerai. Un modèle MIK est censé prendre en compte cet effet, mais consultez la section de rédaction du modèle MIK du présent document pour prendre connaissance des modifications supplémentaires qui pourraient être nécessaires.
c. Dilution et perte externes
Il s'agit de l'incoporation de matière en périphérie des SMU économiques au sein d'un bloc et le long des bords des blocs avec d'autres blocs.
Le lissage du marquage des blocs d'extraction entraîne également une dilution et une perte. Il a été observé que certaines opérations estimeront cet effet manuellement en numérisant une série de polygones de blocs d'extraction à partir du modèle de ressources pour une série de gradins planifiés.
d. Facteurs d'exploitation minière imparfaits (dilution et perte)
Cela fait référence aux effets du fait que les choses ne sont pas parfaites dans l'exploitation minière.
- Le minerai, en particulier le minerai dynamité, quittera son lieu de forage avec contrôle de teneur.
- Le revêtement et le nivellement des routes et des gradins déplacent le minerai et les stériles, ce qui entraîne une dilution et des pertes.
- En raison de la géométrie, le fonctionnement des équipements d'excavation ne peut pas être physiquement associé à la forme et à la taille du corps de minerai. Par conséquent, les excavatrices extrairont des morceaux provenant de blocs adjacents, latéraux et verticaux. Les blocs du modèle de contrôle de teneur sont verticaux, mais l'excavatrice creuse un front de taille à l'angle de forage.
Des erreurs peuvent survenir, y compris des stériles envoyés à l'usine et vice versa, ainsi que des erreurs de sous-creusement ou de sur-creusement de blocs de minerai délimités.
Tous ces éléments doivent être pris en compte et pris en compte dans la conversion d'une ressource minérale en une réserve de minerai.
Les résultats nets de ces sources opérationnelles imparfaites de dilution et de perte sont difficiles à estimer et nécessitent l'utilisation de rapprochements des opérations minières réelles pour les quantifier correctement.
7.2. LISSAGE DU MARQUAGE ET DILUTION/PERTE
Un exemple d'un lissage de marquage entraînant une dilution et des pertes est montré à la figure 35 et à la figure 36. Dans cet exemple, les blocs de contrôle de la teneur dans un bloc de ressource parent qui ont été déterminés en tant que minerai sont indiqués à la figure 35. Toutefois, les géologues du contrôle des teneurs marqueront cette forme de creusement comme étant plus pratique, par exemple, comme le montre la figure 36.
Figure 36 : exemple de géologues du contrôle de la teneur qui procèdent probablement au marquage des blocs de minerai forés dans un bloc parent de ressources
7.3. APPROCHE DE LA COUCHE DE DILUTION
Dans l'approche de la couche de dilution pour les pertes et la dilution, les blocs peuvent être étendus avec une « couche » de matière ou les zones de minerai peuvent être élargies.
Expansions de blocs - Modèles OK
Dans cette approche, le processus est représenté schématiquement à la figure 37.
Une zone de chevauchement avec chacun des blocs voisins est évaluée et le tonnage et la teneur de ce chevauchement sont ajoutés au bloc central. Le nouveau tonnage et la nouvelle teneur du bloc sont une moyenne pondérée en tonnes des tonnes et des teneurs du bloc d'origine ainsi que des tonnes et des teneurs ajoutées de chacun des blocs voisins. Le tonnage doit ensuite être rééquilibré de manière à ce qu'une perte de volume équivalente se produise afin qu'aucun volume supplémentaire ne se crée dans le bloc. La conservation de la masse et la conservation du métal doivent être respectées.
Figure 37 : schéma de l'expansion d'une cellule de modèle de blocs par une couche de dilution
Outre les quatre blocs situés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, il peut être nécessaire de prendre en compte les blocs au-dessus et au-dessous.
L'algorithme peut être conçu pour avoir des tailles de « couche » différentes dans différentes directions.
Expansions de blocs - Modèles MIK
Vous trouverez ci-dessous une méthode d'application d'une couche de dilution dans un modèle MIK.
Supposez que tout volume proportionnel de matière au-dessus d'une teneur de coupure (indicateur) sélectionnée dans un bloc est du même rapport X-Y que le bloc parent. Ajoutez une couche de dilution de taille « d » autour de la proportion de minerai comme indiqué à la figure 38. La couche de dilution aura la teneur de l'incrément en dessous de la valeur de l'indicateur sélectionné. Si le tonnage est insuffisant dans l'incrément ci-dessous, l'incrément suivant est ajouté jusqu'à ce que le tonnage soit atteint.
Si le facteur de tonnage résultant est supérieur à « 1 », il est fixé à une valeur de « 1 ». (En d'autres termes, le tonnage des blocs sera conservé).
Cet ajustement est effectué pour chaque valeur d'indicateur à son tour, ce qui entraîne un ensemble modifié ( « dilué » ) de proportions et de teneurs des indicateurs.
Figure 38 : diagramme de l'algorithme d'application de la couche de dilution pour un bloc MIK
Expansions de modèles filaires
Dans cette méthode, les modèles filaires utilisés pour générer les domaines du modèle de minerai de ressources sont étendus vers l'extérieur à partir du domaine de minerai.
Les blocs de stériles à l'intérieur de la nouvelle structure filaire étendue sont marqués en tant que blocs de minerai à inclure dans l'exploitation minière en tant que minerai ; un sous-cellage peut être nécessaire pour isoler ces blocs.
Ces « blocs de dilution » peuvent ensuite être incorporés dans un planning en tant que minerai lors de la création de tâches par blocs de gradins. Ils peuvent également être étiquetés en tant que lots de minerai lorsque les modèles sont régularisés pour une utilisation dans la préparation du modèle d'optimisation de la fosse Pseudoflow.
Figure 39 : diagramme de l'application d'une couche de dilution pour l'expansion des modèles filaires
Les limitations de cette méthode sont les suivantes :
- Le chevauchement des modèles filaires et des modèles filaires de filons plissés perturbe le processus d'expansion des modèles filaires.
- La construction initiale des modèles filaires doit tenir compte de cette utilisation ultérieure.
- Cela ne convient pas aux corps de minerai plissés.
- Il est nécessaire de vérifier chaque modèle filaire final.
7.4. LES TECHNIQUES DE DILUTION HORS MODÈLE DE BLOCS
Il est à noter que l'objectif de la modélisation de la dilution et de la perte est de s'assurer que nos prévisions à l'aide du modèle de blocs de ressources/réserves sont les plus proches possible de ce que nous pensons qu'il se produira réellement dans la pratique opérationnelle. La meilleure façon d'y parvenir est de s'efforcer de reproduire aussi fidèlement que possible les mécanismes et l'étendue de la dilution et de la perte tels qu'elles se produisent dans la pratique et de rapprocher les résultats de la modélisation avec l'historique lorsqu'ils sont disponibles.
Pour atteindre cet objectif, il sera parfois préférable de modéliser la dilution et la perte en dehors du modèle de blocs et sur des formes minières spécifiques ou des formes de corps de minerai spécifiques pouvant être utilisées pour la planification.
L'une des approches utilisées pour modéliser la dilution a été l'utilisation du « Stope Optimizer » souterrain (https://www.deswik.com/product-detail/deswik-stopeoptimizer/) pour évaluer les formes de minerai exploitables sur des gradins à ciel ouvert, la hauteur des gradins étant la hauteur du chantier.
Figure 40 : coupe d'une fosse à ciel ouvert montrant l'utilisation de Stope Optimizer pour déterminer les formes exploitables pour l'exportation dans un calendrier
8. Avant de commencer à utiliser le modèle de blocs
8.1. COMPRENDRE VOTRE MODÈLE DE BLOCS
Il est extrêmement important de bien comprendre votre modèle de blocs avant de commencer à travailler avec. Attendez-vous à ce que cela prenne quelques jours si vous obtenez un modèle que vous n'avez jamais vu auparavant.
Demandez au minimum aux géologues un tableau récapitulatif du site, de préférence un rapport complet du modèle de ressources.
Assurez-vous de savoir ce que tous les champs signifient. S'agit-il de champs entiers, doubles, chaînes de caractères ? Existe-t-il des champs « calculés », tels que les champs de Surpac qui sont calculés « à la volée » ? Sont-ils tous nécessaires à votre travail ? Quelles valeurs par défaut sont utilisées ? Nous vous recommandons de consulter les statistiques de chacun des champs du modèle.
Quel est le cadre du modèle ? Le cadre est-il au bon endroit ? Les blocs sont-ils réguliers ou irréguliers ? Sont-ils mis en rotation ? Quelle est la taille la plus petite à la plus grande ?
Le modèle de blocs est-il complet dans le cadre ou ne s'agit-il que de certains des blocs du cadre, une grande partie du cadre étant vide ?
Ne présumez pas que le géologue vous a remis un modèle de blocs entièrement prêt pour que vous puissiez commencer vos travaux. Par exemple, il peut avoir des valeurs par défaut de « -99 » pour la densité ou la teneur, et il peut exister encore des blocs dans le modèle avec ces valeurs par défaut. Il suffit qu'un certain nombre de blocs de densité de « -99 » soit inclus dans un modèle de blocs, sans pour autant que ce nombre soit très élevé, pour qu'une interrogation donne des tonnages totalement incorrects !
En outre, sachez que les modèles de blocs géologiques peuvent être imparfaits. Les deux problèmes les plus courants sont un soutien géologique insuffisant (par exemple, des limites lithologiques incertaines et une densité d'échantillons insuffisante) et une intégrité des données déficiente (AQ/CQ médiocres, composants manquants dans l'échantillonnage, tels que des contaminants friables fins dans une noyau de roche dure). Voir la section 5, Problèmes à connaître, présentée antérieurement dans le présent document.
8.2. VÉRIFICATIONS DU MODÈLE DE BLOCS AVANT UTILISATION
Nous aimerions penser que les modèles sont entièrement validés et prêts à l'emploi lorsqu'ils sont remis, mais la réalité est bien différente. Il est donc prudent de procéder aux vérifications suivantes d'un modèle de blocs avant de l'utiliser :
- Vérifiez que vous disposez du dernier modèle de blocs. Enregistrez le nom du fichier fourni et confirmez qu'il s'agit du bon modèle à utiliser.
- Obtenez un résumé des champs du modèle auprès du géologue des ressources. Assurez-vous que le modèle qui vous a été attribué contient ces champs (ou au moins ceux dont vous avez besoin).
- Enregistrez le modèle sous un nom différent du modèle du géologue des ressources (un nom lié à la planification avec la date) et supprimez les champs non nécessaires (par exemple, le « nombre d'échantillons » utilisés dans l'estimation des teneurs et d'autres champs liés à la création de modèles de ressources). Cela rendra le modèle plus petit et plus gérable.
- Vérifiez que les champs minimaux requis sont présents : densité, classe de ressource (mesurée, indiquée, inférée), teneurs et classifications de types de roches/matières.
- Comprenez le cadre du modèle : origine, limites du modèle et taille du bloc parent. Il convient de les noter.
- Déterminez le type de méthode d'estimation par interpolation utilisée dans la construction du modèle de blocs : OK, MIK, CS.
- Vérifiez le minimum et le maximum de tous les champs numériques.
Il est courant de trouver des valeurs de « repère par défaut » de « -99 » toujours présentes dans les blocs (en particulier les blocs d'air). Si de telles valeurs se produisent et que c'est pour une raison évidente (telle qu'un bloc d'air), corrigez-les vous-même (en d'autres termes, mettez-les à « zéro » ). Sinon, renvoyez-le au géologue pour qu'il le corrige.
Assurez-vous que la plage de nombres est logique, en particulier les teneurs et les densités. L'auteur a vu des modèles avec des teneurs supérieures à 100 % dans les blocs. Elles n'ont pas été conçues pour être des valeurs en ppm. Il s'agissait de pourcentages résultant d'équations géochimiques manipulant des analyses PIMA manuelles, leur sens n'étant tout simplement pas vérifié. Vérifiez l'absence de valeurs négatives.
- Vérifiez l'absence de sous-blocage.
- Effectuez des vérifications visuelles de base :
- Vérifiez visuellement que la teneur = 0 dans les zones non définies.
- Vérifiez visuellement que les classes de ressources en minerai semblent appropriées.
- Vérifiez visuellement la cohérence entre les champs. Par exemple, si la densité = 0, assurez-vous que la teneur est également égale à 0.
- Déterminez si les valeurs du modèle sont un « bloc entier » ou un « bloc partiel ». ( « Bloc partiel » signifie qu'il peut y avoir plusieurs types de matières dans un seul bloc et qu'il est doté de champs spécifiant la proportion de chaque matière dans ce bloc.)
- Vérifiez le rapport sur les ressources (ou auprès de la personne qui a généré le modèle) pour toute dilution appliquée à la ressource.
- Vérifiez les tonnes et la teneur du modèle global en exécutant des rapports dans CAD pour la ressource totale à trois niveaux de coupure différents ou plus et par classe de ressources. Comparez avec les totaux indiqués dans le rapport du géologue sur les ressources. (Cela peut être pour l'ensemble du modèle ou pour un sous-ensemble particulier, par exemple à l'intérieur d'une enveloppe de ressource minérale.)
- Déterminez la taille de la SMU utilisée par le géologue (le cas échéant) dans la création du modèle.
- Déterminez comment la densité a été estimée. (Cela vous permettra de comprendre les niveaux de précision. Ont-ils été manipulés ? S'agit-il d'une simple affectation de la moyenne en vrac pour le type de roches ? Sont-ils basés sur un calcul à partir de la minéralogie ? )
- Pour les modèles MIK, vérifiez les erreurs de relation d'ordre et corrigez-les (ou faites-les corriger). De telles erreurs peuvent parfois causer des perturbations majeures dans votre travail ultérieur.
- Vérifiez les modèles filaires pour les limites d'oxydation par rapport aux types de matières des modèles de blocs.
- Vérifiez les modèles filaires en ce qui concerne le domaine géologique codé dans le modèle.
Références
Abzalov, M.Z. (2006) Localised uniform conditioning (LUC): A new approach for direct modeling of small blocks. Mathematical Geology, 38(4). DOI: 10.1007/s11004-005-9024-6.
Badiozamani, K. (1992). Computer Methods. Dans Hartman, H.L. (Ed.), SME Mining Engineering Handbook (pp. 598-626). Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.
Bannister, K. (2016). Estimation of Open Cut Mining Recovery and Mining Dilution. Obtenu à partir de from http://www.kbpl.com.au/ KBPL%20Mining%20Recovery%20and%20Dilution.pdf.
Bertinshaw, R. et Lipton, I. (2007). Estimating mining factors in open pit mines. Dans (The Australasian Institute of Mining and Metallurgy : Perth). 6e conférence sur l'exploitation minière à ciel ouvert de 2007 : 10-11 septembre 2007, Perth, Australie occidentale, pp. 13-17.
Caers, J. (2000). Adding local accuracy to direct sequential simulation. Mathematical Geology, 32(7) : 815-850. DOI : 10.1023/A : 1007596423578.
Coombes, J. (2008). The Art and Science of Resource Estimation – a practical guide for geologists and engineers. Perth : Coombes Capability.
Cowan, E.J. (2014). ‘X-ray Plunge Projection’— Understanding Structural Geology from Grade Data. In AusIMM Monograph 30: Mineral Resource and Ore Reserve Estimation — The AusIMM Guide to Good Practice, second edition, pp. 207-220.
De-Vitry C., Vann, J. and Arvidson, H. (2007). A Guide to Selecting the Optimal Method of Resource Estimation for Multivariate Iron Ore Deposits. Dans Iron Ore 2007, 20-22 août 2007, Perth Australia : pp 67-77, (Melbourne: The Australian Institute of Mining and Metallurgy).
Dimitrakopoulos, R., Martinez, L. & Ramazan, S. (2007). A maximum upside / minimum downside approach to the traditional optimization of open pit mine design. Journal of Mining Science, 43(1), pp. 73-82. DOI : 10.1007/s10913-007-0009-3.
Dominy, S.C., Noppé, M.A. & Annels, A.E. (2002). Errors and Uncertainty in Mineral Resource and Ore Reserve Estimation: The Importance of Getting it Right. Exploration and Mining Geology, 11(1-4), pp. 77-98.
Dowd, P. (2018). Quantifying the Impacts of Uncertainty. Dans Daya Sagar, B.S., Cheng, Q. & Agterberg, F. (Eds). Handbook of Mathematical Geosciences. Cham : Springer Open. DOI : 10.1007/978- 3-319-78999-6_18.
Hardtke, W., Allen, L. & Douglas, I. (2011). Localised Indicator Kriging. Dans Baafi, E.Y., Kininmonth, R.J. & Porter, I. (Eds). Application of Computers and Operations Research in the Minerals Industry, 24-30 septembre 2011, University of Wollongong, New South Wales, Australia : proceedings, pp 141-147. Wollongong, NSW : Australian Institute of Mining and Metallurgy.
Heidari, S.M. (2015). Quantification of Geological Uncertainty and Mine Planning Risk using Metric Spaces (thèse de doctorat) The University of New South Wales, Sydney, Australia.
Hoppe, R.W. (1978). Stekenjokk : a mixed bag of tough geology and good mining and milling practices. Dans Sisselman, R. (Ed.). Engineering and mining journal operating handbook of underground mining, pp 270–274. New York : E/MJ Mining informational Services.
Jackson, S., Frederickson, D., Stewart, M., Vann, J., Burke, A., Dugdale, J. & Bertoli, O. (2003). Geological and grade risk at the Golden Gift and Magdala Gold Deposits, Stawell, Victoria, Australia. Dans Dominy, S. (Ed.). Proceedings / 5th International Mining Geology Conference, pp. 207-214. Melbourne : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy.
Journel, A.G., Kyriakidis, P.C. & Mao, S. (2000). Correcting the smoothing effect of estimators : A spectral postprocessor. Mathematical Geology, 32(7):787-813. DOI : 10.1023/A : 1007544406740.
Leuangthong, O., Neufeld, C., & Deutsch, C.V. (2003). Optimal selection of selective mining unit (SMU) size. International Conference on Mining Innovation (MININ), pp. 1-16. Santiago, Chile.
McCarthy, P. (2003)/ Managing technical risk for mine feasibility studies. Dans Proceedings Mining Risk Management Conference 2003, pp. 21-27. Melbourne : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy.
Odins, P. (2011). HARP modelling – a new method of representing complex stratigraphic deposits, in Eighth International Mining Geology Conference Proceedings 2011, pp 395-402. Melbourne : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy.
Rocca, F., Sebbag, M. & Taimre, T. (2007). Buzwagi open pit study. Dans 6th Large Open Pit Mining Conference 2007 : 10-11 septembre 2007, Perth, Western Australia, pp. 119-128. Carlton, Victoria : Australasian Institute of Mining and Metallurgy.
Stephenson, P. (2015). Mineral Resources, Mineral Reserves or Pie in the Sky? Webinar Presentation, Toronto, Ontario, 27 novembre 2015, AMC Consultants.
Stephenson, P. 2009. “Mineral Resource/Reserve Classification and Reporting, Including Comparison of NI43-101 with other National reporting Standards”, Presentation to Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, Burnaby, British Columbia, 21 octobre 2009
Stephenson, P.R., Allman, A., Carville, D.P., Stoker, P.T., Mokos, P., Tyrrell, J. & Burrows, T. (2006). Mineral Resource Classification – It’s Time to Shoot the ‘Spotted Dog’!. Dans Dominy, S. (Ed.). Proceedings Sixth International Mining Geology Conference, Darwin, Australia, août 2006, pp. 91-95. Carlton, Victoria : Australasian Institute of Mining and Metallurgy.
Vann, J. (2005). Recoverable Resource Estimation. One day short course, QG, juillet 2005.
Vann, J., Guibal, D. & Harley, M. (2000). Multiple Indicator Kriging - Is it Suited to My Deposit?. Dans 4th International Mining Geology Conference, 14-17 mai 2000, Coolum, Qld, pp 187-194. Carlton, Victoria : Australasian Institute of Mining and Metallurgy.